 Tous les messages Tous les messages
#361
Piet Mondrian
Loriane
Posté le : 31/01/2015 20:07
Le 1er février 1944 à New York meurt, à 71 ans Pieter Cornelis
Mondrian appelé Piet Mondrian à partir de 1912, né le 7 mars 1872 à Amersfoort Pays-Bas, peintre néerlandais reconnu comme un des pionniers de l’abstraction, art abstrait, Néoplasticisme, ses Œuvres réputées sont Dune, Moulin au soleil, Composition n°7, Broadway Boogie-Woogie L'œuvre de Mondrian est l'une des plus radicales qui soient de tout l'art du XXe siècle, ce qui explique sans doute pourquoi on l'a longtemps si mal comprise. Ses toiles furent d'abord tenues pour des modèles expérimentaux dont architectes et designers auraient à s'inspirer. Ses tableaux devinrent ensuite le parangon de ce qu'on nommait l' abstraction géométrique », ou le « style » par opposition à l'abstraction lyrique ou le cri, et les commentaires allaient bon train sur la « géométrie secrète du peintre. Enfin, on interpréta son œuvre comme le testament d'un prophète néo-platonicien dévoilant la vérité du monde sous le voile des apparences. De chacune de ces lectures, Mondrian lui-même est en partie responsable elles peuvent toutes s'appuyer sur les contradictions des très nombreux textes qu'il écrivit tout au long de sa vie. Mais elles demeurent toutes aveugles à l'enjeu de son travail, au fondement de la formidable tâche qu'il s'était assignée, à savoir la remise en cause absolue de la tradition picturale depuis la Renaissance. Je crois que l'élément destructeur est trop négligé en art, dira-t-il à la fin de sa vie : c'est en analysant la nature toute dialectique de ce travail de destruction que l'on peut aujourd'hui enfin commencer à apprécier son art pour ce qu'il est, une redéfinition de la peinture. En bref Né dans une famille calviniste, Piet Mondriaan aurait pu devenir prédicateur. En fait, il passe un diplôme de professeur de dessin, mais renonce à l'enseignement pour suivre les cours de peinture à l'Académie royale d'Amsterdam. Peintre figuratif à ses débuts, il se consacre surtout au paysage Moulin au bord de l'eau, vers 1900, MoMA, New York. Puis il découvre successivement le fauvisme, sous l'influence de son compatriote Van Gogh, et le cubisme, en voyant les tableaux de Picasso et de Braque, dont il va assimiler les leçons. Arrivé en 1912 à Paris – où il choisit d'orthographier son nom avec un seul a –, Mondrian peint ses sujets (Pommier en fleur, 1912, MoMA, New York ; Nature morte au pot de gingembre, id. en décomposant géométriquement les formes, puis en les réduisant aux seules lignes verticales et horizontales, aux + et aux − Comme, dès 1913, il n'utilise plus dans ses titres que le mot composition, il en arrivera à ces séries dites Compositions plus-minus, où l'horizontal et le vertical sont, dans son idée, comme les symboles du masculin et du féminin Composition avec lignes, 1917, musée Kröller-Müller, Otterlo. C'est au cours de cette période, passée à Amsterdam, qu'il commence aussi à peindre en à-plats utilisant des plans rectangulaires de couleurs pures, dont les limites sont précisées, voire soulignées par de fins traits noirs disséminés sur l'ensemble de la toile Composition en couleur B, 1917, musée d'Art moderne, Eindhoven. En 1918, il opte pour des formes géométriques aux contours gris, qui occupent la totalité de la surface. Il entame aussi la série des compositions en losange carrés présentés sur la pointe. Dès 1917, Mondrian a donné naissance, avec Theo Van Doesburg, au groupe De Stijl, dont la revue devient l'organe de l'art abstrait. Les articles théoriques qu'il y publie, entre 1917 et 1922, font de lui un véritable maître à penser de l'abstraction, sous la forme du néoplasticisme, qu'il dédie aux hommes futurs . De 1919 à 1938, Mondrian vit à Paris. Il y exécutera près de soixante-dix tableaux, restant désormais fidèle à ses principes, qu'il codifie dans la brochure précisément intitulée le Néoplasticisme 1920 : emploi exclusif de lignes droites se coupant à angle droit – ce dernier étant défini comme l' expression plastique de ce qui est constant ; gamme limitée aux couleurs primaires pures jaune, rouge, bleu et aux «non-couleurs blanc, noir ; exclusion de la symétrie et opposition horizontal-vertical. Après avoir rompu avec De Stijl en 1925, il rejoint les artistes du groupe Cercle et Carré 1930, auquel succédera Abstraction-Création 1931. Tandis que sa peinture a de plus en plus tendance à privilégier les rectangles blancs et à cantonner la couleur à de petits rectangles en bordure de toile, il présente en 1930 sa Composition II avec lignes noires sur fond blanc musée d'Art moderne, Eindhoven, en 1932 sa Composition avec bleu et jaune Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, où il introduit le principe des lignes parallèles très proches l'une de l'autre, et en 1933 sa Composition avec lignes jaunes Musée municipal, La Haye, faite de quatre lignes qui traversent – sans se couper – un carré blanc. Après avoir quitté Paris pour Londres en 1938, Mondrian s'installe définitivement à New York en 1940. Il a près de 70 ans quand, renonçant à certains de ses principes, il donne à nouveau des titres à ses compositions : ce seront, par exemple, New York City 1941-1944, collection privée ou Broadway Boogie-Woogie 1942-1943, MoMA, New York. Emporté par une pneumonie, il laisse inachevé son Victory Boogie-Woogie collection privée, hommage au jazz qui a toujours exercé sur lui un profond attrait et qui est, à ses yeux, aussi radicalement révolutionnaire que le néoplasticisme. L'artiste théosophe, Art géométrique, dit-on du néoplasticisme. Piet Mondrian chercha, en effet, à élaborer une peinture plane dans le plan – dont le modèle de la grille, tout au long de son œuvre, préserva l'intégrité – et, à l'harmonie de la nature, il substitua l'harmonie d'un art fondé sur l'équilibre entre de nouveaux rapports : rapports de position l'angle droit, mais aussi rapports de proportions et de couleurs. Dans le tableau, écrivait-il, tout se compose par relation et réciprocité. En ouvrant la voie à un nouveau langage pictural, Mondrian ne s'est pas caché de mener une quête du spirituel dans l'art, qui ne serait pas sans rapport » avec la théosophie, dont il s'était toujours senti proche. Cette doctrine, qui visait à la connaissance de Dieu par l'approfondissement de la vie intérieure, serait ainsi à l'origine, non seulement de son tempérament ascétique, mais aussi de sa nouvelle vision esthétique. Style Il est, avec les Russes Vassily Kandinsky et Kasimir Malevitch, parmi les premiers peintres à s'être exprimé en utilisant un langage abstrait. La réputation de Mondrian s’est construite dès le début de sa carrière selon une représentation transcendantale de l'image en particulier dans le paysage, basée sur l'épuration radicale du tableau. Toute trace de référence au naturel visible est progressivement évacuée au profit d'une vision de l'Universel. Mondrian privilégie l'économie de moyens pour faire jouer les paramètres qu'il a choisi. Cette méthode se manifeste depuis son interprétation de plus en plus abstraite du cubisme analytique de 1912 à 1914 à Paris, jusqu'à ce qu'en 1917, de retour à Paris jusqu'en 1938 il concentre tous ses moyens sur la construction d'une composition équilibrée faite de formes réduites et allongées à des rectangles et quelques couleurs, placées sur une trame orthogonale, le tout décliné en séries jusqu'à la fin de sa vie. La rigueur de sa démarche et son évolution est évoquée dans ses écrits théoriques. Mondrian est une des figures majeures de l'art moderne du XXe siècle, dans le monde de l'art moderne et aussi par son implication auprès d'architectes et de designers, dans des productions modernes, du mobilier jusqu'aux objets industriels de consommation courante, ou dans de nouveaux espaces, privés et publics. Sa vie en Périodes et dates 1872 - 1907 Le père de Mondrian, instituteur, était aussi un pasteur calviniste, un homme exalté et qui dessinait souvent. Il encouragea son fils, mais faute de moyens s'opposa à ce que celui-ci s'inscrive, à vingt ans, en 1892, à l'Académie nationale des beaux arts d'Amsterdam. Mondrian a été initié par son oncle à la peinture de plein air, une innovation dans les années 1880, un héritage de Johan Barthold Jongkind et de l'école de La Haye. Dans la structure des paysages d'avant 1900 Mondrian vise des effets d'ensemble : effets de lumière, effets linéaires, groupes de troncs d'arbres et branches en contre-jour sont des motifs récurrents. Ce sont des qualités morales qui s'inscrivent dans ces choix de couleurs et ces motifs. L'art de tradition romantique-nordique produisit vers 1900 beaucoup de paysages de sous bois. En octobre 1892, il s'inscrit à l'Académie royale des beaux-arts d'Amsterdam. Plus généralement après 1900, les tableaux de Mondrian cherche à faire voir des idées, et semble proche du mouvement symboliste. Son nouveau style, comme cristallisé sur des formes-idées, déjà visible dans Passiebloem Passiflore, vers 1901, s'est manifesté d'autant plus vigoureusement qu'il rencontra en juin 1908 le peintre Jan Toorop, personnage central du Symbolisme hollandais connu par ses curieuses compositions de figures curvilinéaires Quoi ? très homogènes, comme fondues dans les plissements géologiques du dessin. Vers 1907 Le nuage rouge très grande œuvre. il développe un style d'esquisse où la structure graphique se porte sur quelques rares formes[pas clair], le tableau se vide et les couleurs se font plus acides. C'est à ce moment-là qu'il aurait découvert, chez Jan Sluijters, l'emploi arbitraire de la couleur et les dessins de Van Dongen d'alors, relevant du Fauvisme le plus intense5. 1908 - 1911 Les œuvres de Van Gogh, découvertes lors d'une rétrospective à Amsterdam en 19056 et à nouveau exposées à Amsterdam en septembre et octobre 19087, auront eu un effet amplificateur sur ce qui était en cours après la rencontre avec Toorop. Le tableau Devotie Dévotion, 1908, semble en découler. Plus près encore du dernier Van Gogh : Moulin dans la clarté du soleil, de 1908. C'est dans un élan d'un lyrisme inouï que Mondrian intensifie à l'extrême l'idée contenue dans le "moulin /soleil". Sur un mètre quinze, la stridulence des rouges hachés de gris bleu sur un ciel tout morcelé dans une mosaïque de bleus pâles et de jaunes citron. Depuis 1904, il s'intéresse à la théosophie, aux mathématiques et à la géométrie. En 1909, il s'inscrit à la société théosophique. La pensée théosophique, développée dans la seconde moitié du xixe siècle par Helena Blavatsky, met en avant l'idée d'un ordre cosmique du monde, au-delà des apparences et du visible. Mondrian est sensible à cette recherche d'une peinture plus spirituelle. La transcendance du traitement de la lumière, décomposée sur des formes simples en contrastes de couleurs saturées, le conduit vers une abstraction croissante. Le monumental Duinlandschap Paysage de dunes, 1910/11, réduit le sujet du tableau à n'être plus que l'oblique d'une ligne où l'horizon bascule dans une mosaïque de losanges hachurés. 1911 - 1916 En octobre 1911, Mondrian voit à Amsterdam des œuvres de Georges Braque, radicales dans leur cubisme analytique affirmé. Comme deux alpinistes encordés, Braque et Picasso, s'étaient lancés vers les cimes de l'expérimentation pure. À la fin de l'année, Mondrian est à Paris. D'abord installé au 33 avenue du Maine, il déménage en mai 1912 dans un atelier au 26 rue du Départ, près de la gare Montparnasse. Pieter Cornelis Mondrian décida de se faire dorénavant appeler Piet Mondrian. Tout de suite, il va prendre le chemin du cubisme, et abandonne en conséquence les couleurs vives, réduisant sa palette à des gammes de gris et d'ocres. Du cubisme, il dira : Je sentis que seuls les cubistes avaient découvert le droit chemin et pendant longtemps je fus très influencé par eux. Et rapidement, il amplifie la tendance à l'abstraction qui travaille le cubisme analytique : les séries d'expérimentations construites avec les motifs du pot de gingembre et du pommier en fleurs atteignent la frontière où la figure s'efface dans une structure. Elle se réduit à des variations formelles sur quelques signes : courbes tendues des branches et leurs tension dans l'espace, verticalement, mais rabattue vers l'horizontale avec le temps. Entre 1913 et 1914, son cheminement l'amène à créer un langage pictural nouveau, ce qui en fait l'un des chefs de file et pionniers de l'art abstrait, alors en construction et en effervescence, aux côtés de Kandinsky, Kupka, Fernand Léger, Picabia, Robert Delaunay et Sonia Delaunay. En janvier 1914, Mondrian écrit à son ami Bremmer : Je construis des lignes et des combinaisons de couleurs sur des surfaces planes afin d'exprimer, avec la plus grande conscience, une beauté générale. La nature ou ce que je vois m'inspire, me met, comme tout peintre, dans un état émotionnel qui me pousse à créer quelque chose, mais je veux rester aussi près que possible de la vérité et à tout extraire, jusqu'à ce que j'atteigne au fondement qui ne demeure qu'un fondement extérieur ! des choses …. Je crois qu'il est possible, grâce à des lignes horizontales et verticales construites en pleine conscience, mais sans ‘‘calcul’’, suggérées par une intuition aigüe et nées de l'harmonie et du rythme, que ces formes fondamentales de la beauté, complétées au besoin par d'autres lignes droites ou courbes, puissent produire une œuvre d'art aussi puissante que vraie. En 1915, de retour au pays en raison de la mort de son père, il s'emploie à dépasser le cubisme dont il souligne les insuffisances et il évolue alors vers une abstraction plus pure. Les dessins composés sur le motif d'une jetée dans l'Océan aboutissent à la simplification radicale du graphisme à de simples tirets horizontaux et verticaux. Le sujet son sens universel semble s'effacer dans le processus de construction plastique du tableau. Durant cette année 1915, Mondrian entame de nombreux tableaux, fait de nombreux essais, mais n'achève presque aucune œuvre, excepté la Composition en noir et blanc, qui prend le thème de la mer avec une jetée, et se compose de courts segments de droite disposés à l'horizontale et à la verticale, formant des croix sur un fond gris regroupés dans un ovale. Ce tableau fait la synthèse des recherches de l'année. 1917 - 1938 Mondrian fut un contributeur très important de la revue hollandaise De Stijl fondée par Theo van Doesburg en 1917, le titre de cette revue donnant son nom au mouvement, De Stijl ne fut jamais un mouvement véritable. De retour à Paris en 1919, Mondrian prend possession de son nouvel atelier, au 26 de la rue du Départ, qui sera peu à peu envahi de cartons de couleurs et disposés et déplacés au gré des changements qui affectent l’espace de l’atelier, sur les toiles abouties ou en cours de réalisation. Les toiles se prolongent ainsi dans l’atelier qui affecte en retour le contenu des toiles et participe provisoirement à leur forme et à leur place. Il fait publier dans la revue De Stijl parmi de nombreux écrits son essai Réalité naturelle et réalité abstraite. Il souhaite écarter la nature matérielle au profit de son essence. Aussi écarte-t-il la forme et la couleur naturelles » et au premier chef la courbe et le vert, pour ne plus s'exprimer que par « l’abstraction de toute forme et couleur, c'est-à-dire ... la ligne droite et la couleur primaire nettement définie. Il travaille donc à partir de 1920 avec les couleurs pures : rouge, jaune et bleu, qu’il associe au blanc, qui lui sert de fond, et au noir, qui délimite les couleurs entre elles. Il structure ses œuvres de manière géométrique en utilisant essentiellement des formes rectangulaires et des lignes d’épaisseur variable. Les croyances théosophiques de Mondrian lui font accorder à l’angle droit une signification universelle. Plus que tout compte le rapport entre couleurs, entre dimensions, entre positions. En effet, pour lui, le rapport [de la verticale à l'horizontale] est à l’image de la dualité et des oppositions qui régissent d’une façon générale la vie et l’univers - le masculin et le féminin, l’extérieur et l’intérieur, le matériel et le spirituel. Mondrian défini dès lors son système de représentation qu’il nomme peinture néo-plastique et qu’il développera pendant plus de 20 ans jusqu’à son séjour à New York. Il travaille toujours à la fois instinctivement et avec une grande rigueur. Les séries de variations, strictement numérotées à partir de 1920, enchaînent toutes les possibilités plastiques. En 1930, il se contraint à ne travailler plus qu’avec la ligne, sans aucune couleur. La Composition losangique avec double ligne lui permet de retrouver une nouvelle variable : la double ligne. Et la couleur réapparaît… En 1928, les œuvres de Mondrian et de Nicolas Eekman seront exposées ensemble à la galerie Jeanne Bucher. En 1930, il devient membre du groupe Cercle et Carré fondé par son ami Michel Seuphor et par Joaquin Torres Garcia. En 1931, il devient membre du groupe Abstraction-Création, fondé par Vantongerloo et Auguste Herbin. C’est alors une figure majeure du mouvement moderne dans les arts et en architecture. En 1931, la styliste de mode Lola Prusac crée pour la Maison Hermès sellier à Paris crée une gamme de valises et de sacs à incrustations géométriques bleu et rouge qui sont très inspirées des œuvres de Mondrian de cette période. 1938 - 1944 En 1938 il se réfugie à Londres, puis en 1940, suite aux bombardements de Londres s'embarque, en octobre, pour New York. Il y trouve une ville en correspondance avec ses tableaux, ne serait-ce que par son plan, mais aussi par son rythme. Depuis longtemps passionné par le jazz, il adopte avec enthousiasme le boogie-woogie et réalise plusieurs chefs-d’œuvre : Broadway Boogie-Woogie, New York City, et enfin Victory Boogie Woogie qui resta inachevé à sa mort. Rapidement intégré au monde de l'art avec l’appui de Peggy Guggenheim et devint l'ami de Max Ernst. Il fut sollicité pour divers jurys d'expositions et à cette occasion fit remarquer à Peggy Guggenheim la valeur naissante de Jackson Pollock. Il fut aussi vite intégré avec les honneurs dans le groupe des American Abstract Artists. Du 21 mars au 13 mai 1945, le Museum Of Modern Art de New York lui rendait hommage avec un accrochage respectueux16 où le monde de l'art découvrit les peintures réalisées aux États-Unis. Construites sur le jeu orthogonal de lignes colorées, celles-ci acquirent dans ses derniers tableaux une vibration surprenante. Visible dès la phase d'étude, cette vibration était obtenue grâce à une mise en place par tâtonnement de petits morceaux de papiers, peints à l'huile, posés les uns à côté des autres, avec la fragilité des Post-it. Victory Boogie Woogie resta ainsi dans l'atelier11 dans cet état flottant, ouvert au public pendant les six semaines qui suivirent la mort de l'artiste. Une pratique sérielle Bien qu'il ait peint dès son plus jeune âge sous l'influence de son père et de son oncle – le premier, auteur d'affiches nationalistes et religieuses, et le second, membre influent de l'école de La Haye (version hollandaise et tardive de l'école de Barbizon) –, Mondrian mit fort longtemps à parvenir au style « néo-plastique », pour lequel il est justement célèbre : ce style n'émerge pas avant 1920, alors qu'il a près de cinquante ans. D'abord étudiant à la Rijksakademie d'Amsterdam (1892-1894), il y est fort médiocre et doit se contenter d'y suivre des cours du soir de dessin (1895-1897). Et même si les paysages de 1898-1908 font preuve d'une originalité croissante dans leur intérêt pour le cadrage et la frontalité (troncature du champ visuel et parallélisme de la structure interne de l'image avec les côtés du tableau), il serait faux de voir dans son œuvre tardive la simple continuation logique de ces toiles de jeunesse (proposée par Mondrian lui-même vers 1917 afin de faire pardonner au public l'aridité apparente de l'abstraction, cette interprétation allait conduire maints historiens et critiques à lire ses tableaux néo-plastiques comme la stylisation extrême de motifs naturels). Pourtant, une habitude de travail – la pratique sérielle – indique très tôt chez Mondrian sa difficulté à accepter pleinement les termes de la tradition picturale à laquelle il voulait encore appartenir. Avant même qu'il ne connaisse les séries de Monet, Mondrian s'intéressa à la tension s'établissant entre la structure générale d'un motif et la diversité possible de ses aspects : dès ses premières séries de paysages, il cherche toujours à retrouver le type, l'universel, l'invariant, sous le particulier, le contingent. Transition C'est autour de 1908 qu'il découvre Van Gogh, le divisionnisme de Seurat et des autres peintres néo-impressionnistes, et l'œuvre des fauves à travers celle de leurs suiveurs hollandais : « La première chose à changer dans ma peinture fut la couleur, écrira-t-il en 1942, j'ai remplacé la couleur naturelle par la couleur pure. J'en était venu à comprendre qu'on ne peut représenter les couleurs de la nature sur la toile. » Cette confrontation abrupte avec le passé récent de la modernité picturale – dont Bois près d'Oele de 1908 (Gemeentemuseum, La Haye) marque le départ en combinant couleur « fauve » et courbes « modern style » – donne lieu pendant quatre ans à de nombreux tâtonnements, une période de transition qui constitue la véritable formation plastique (autodidacte) de Mondrian. Accentuant sa pratique sérielle (en peignant différentes versions aux couleurs également saturées d'un même motif – l'église ou les dunes de Domburg, la tour-phare de Westkapelle – l'une dans un style « pointilliste », l'autre en s'inspirant de Munch, une autre encore en s'inspirant de Hodler ou de Van Gogh), Mondrian se pose la même question qui conduira un Kandinsky, en face des meules de Monet, à envisager la possibilité de l'abstraction : si le motif n'est qu'un prétexte à magnifier la couleur pure, ne peut-on pas s'en dispenser ? La « vérité » ne peut-elle s'exprimer directement, sans qu'on l'habille de ce vêtement mondain désormais inutile ? Il est alors trop tôt pour qu'il puisse répondre par l'affirmative, et l'influence du symbolisme fournit à Mondrian un dérivatif. Les toiles de la fin de cette période de transition deviennent de véritables rébus dont l'iconologie ésotérique est à décrypter selon le système pseudo-philosophique de la théosophie qu'il vient de découvrir et qui canalise sa volonté idéaliste de transcendance. La géométrie naturelle du chrysanthème devient emblème de l'ordre macrocosmique, les cheveux roux d'une orante, le signe de l'intensité de sa piété (Dévotion, 1908, Gemeentemuseum, La Haye), les trois femmes du triptyque Évolution (1910-1911, Gemeentemuseum, La Haye), à la symétrie rigide et au symbolisme grossier, sont l'icône programmatique de l'histoire humaine : tout semble désigner cette période fortement symbolisante de Mondrian comme offrant la « clef » permettant d'interpréter son œuvre tardive, et malheureusement là encore nombreux sont les historiens et critiques qui ont fait cette erreur. En fait, elle représente dans l'œuvre de Mondrian une régression vers ce que l'on nommait alors la « peinture littéraire ». Découverte du cubisme Au moment même où il expose Évolution, en 1911, Mondrian découvre tout à la fois Cézanne et le cubisme cézannien de Braque et de Picasso, et ce choc déclenche chez lui le processus qui le conduira à l'abstraction. Il s'aperçoit qu'on ne peut atteindre le but qu'il s'est fixé, peindre l'« universel », en personnifiant l'idée de l'absolu sur le mode allégorique comme il l'a fait dans ses toiles directement inspirées de la doctrine théosophique : personnifiée, cette idée devient « particulière », mondaine, et l'image exprime tout le contraire de ce à quoi elle aspire. Mondrian commence à comprendre qu'il ne pourra atteindre ce but en demeurant prisonnier de l'esthétique traditionnelle de l'Occident. Pourquoi ? Parce que celle-ci est fondée, depuis l'Antiquité grecque, sur les oppositions entre figure et fond d'une part, sens et forme de l'autre. Ce n'est qu'en abolissant ces oppositions que l'on pourra avoir accès à l'absolu en peinture, car elles font chaque fois retomber toute tentative pour peindre l'« universel » dans l'ordre de ce que Mondrian nomme le « particulier » (ou encore le « tragique » du sens ou l'identité de la « forme »). Dès lors, tout son art va s'employer à ce travail de sape dont l'enjeu est considérable : il s'agit de trouver le « degré zéro » de la peinture, son « essence universelle », et d'éliminer toute perception « particulière » qui serait un obstacle sur la voie de son appréhension. Logiquement, la reconnaissance de la surface du tableau en tant qu'unité impondérable de l'art pictural devient le centre de la problématique de Mondrian. C'est d'abord embryonnaire dans ses première toiles protocubistes de 1911-1912, mais devient manifeste avec la première toile qu'il peint à son arrivée à Paris au printemps de 1912. Dans la Nature morte au pot de gingembre, II, Gemeentemuseum, La Haye, qui reprend le motif d'une toile d'inspiration cézannienne portant le même titre et qui la précède immédiatement, Mondrian tente d'inscrire toutes les figures dans les mailles d'une grille linéaire qui contrôle toute la surface du tableau. L'individualité de chaque sujet, sa « localité » comme disait Cézanne, est sinon entièrement détruite, du moins presque entièrement effacée. Découvrant l'hermétisme du cubisme analytique de Braque et de Picasso, Mondrian en reprend très rapidement divers procédés sans en adopter la visée esthétique, comme le remarque alors finement Apollinaire (des cubistes, il emprunte la palette colorée aux tons ocres et gris et un cadre ovale ou l'estompage des contours à la périphérie du tableau). Dans la décomposition par plans à laquelle il soumet ses motifs, il ne s'agit pas pour lui, comme pour Picasso qu'il admire par-dessus tout, d'analyser la nature sémiologique des codes picturaux et la condition minimale de « lisibilité » des signes articulés selon ces codes, mais d'unifier le champ pictural de sa toile et de le « déhiérarchiser » par un quadrillage linéaire ancrant toute surface dépeinte sur la surface littérale du tableau et prévenant tout creusement optique excessif de cette surface. Les deux années et demie que Mondrian passe à Paris sont extraordinairement productives. Peu à peu, il en vient à privilégier des motifs frontalisés en ce qu'ils simplifient l'identification entre surface dépeinte et plan du tableau. Après une série d'arbres reprenant des dessins faits aux Pays-Bas et évoluant graduellement vers une suppression de la verticalité et de la courbe au profit d'une organisation réticulaire de la surface de ses toiles, Mondrian a une prédilection pour un motif spécifiquement parisien, l'élévation d'immeubles en déconstruction, véritable mise à nu bigarrée de l'intérieur des appartements, avec leurs juxtapositions fortuites et colorées de papiers peints et de pans de couleur. Les dernières toiles de cette série, avec leur emphase sur l'opposition verticale/horizontale, et l'utilisation nouvelle qu'y fait Mondrian d'une palette colorée dérivée des couleurs primaires (rose, bleu clair, brun-jaune), annoncent le style à venir du néo-plasticisme. Vers l'abstraction Étant retourné en Hollande pour l'été de 1914, Mondrian y est a son grand déplaisir bloqué par la guerre. Loin des façades parisiennes, il se retrouve à Domburg devant les deux motifs qui l'y avaient autrefois tant séduit, la petite église et la mer. Mais il est cette fois dans un tout autre état d'esprit : il a fait l'expérience du cubisme, et les carnets de croquis de cette époque, remplis d'annotations, montrent qu'il réfléchit intensément à la question de l'abstraction (il commençait notamment à élaborer, toujours sous l'influence de la théosophie, ses théories sur l'équilibre cosmique du vertical et de l'horizontal – c'est-à-dire aussi sur l'équilibre du spirituel/masculin et du matériel/féminin). Il entreprend alors deux séries de dessins qui aboutiront chacune à un tableau, unique production picturale de deux années cruciales dans son art (Jetée et océan, 1915, Musée Kröller-Müller, Otterlo ; Composition, 1916, Guggenheim Museum, New York). Dans chacune de ces séries, où Mondrian atteint le « point de non-retour » dans son évolution le conduisant à l'abstraction, une solution à première vue parfaite est rejetée au profit de ce qui semble d'abord un retour au naturalisme : aux splendides dessins ne décrivant de la mer que son horizontalité – c'est-à-dire un concept abstrait – font suite des études qui réintroduisent dans ce réseau de notations géométriques, souvent nommées plus/moins par les historiens d'art, le motif concret de la jetée vue frontalement et en contre-plongée perspective ; même chose pour les dessins de la façade de Domburg : exaltant d'abord son rythme ascensionnel, ils incorporent ensuite des détails « figuratifs » – une double arcade écrasée qui vient limiter cette verticalité. Or ce qui pourrait être pris pour une « régression », pour un retour à une plus grande dépendance vis-à-vis du motif, de la nature visible, est en fait une solution formelle qui allait précipiter Mondrian vers le néo-plasticisme, c'est-à-dire vers un art où chaque élément est, selon ses mots, « déterminé par son contraire » : la pure horizontalité de la mer ne peut être traduite en termes abstraits (ou absolus, ou universels), malgré sa nature conceptuelle, car elle privilégie un terme de l'opposition sur laquelle est fondé le système de pensée de Mondrian, et il en va de même pour le rythme ascensionnel de la série des façades d'église. Les deux toiles qui concluent ces deux séries graphiques démontrent en outre comment par la neutralisation réciproque de la verticalité et de l'horizontalité, premier trait caractéristique de ce qu'on peut nommer la dialectique propre à Mondrian, le peintre débouche sur une radicalisation de ce qui faisait le fond de son œuvre cubiste, à savoir sa volonté d'anéantir l'opposition de la figure et du fond (dans les deux toiles, d'ailleurs, on peut retrouver la trace du cubisme qu'elles dépassent : la composition en ovale de Jetée et océan ; l'estompage des couleurs à la périphérie et surtout l'indépendance contrapruntique du dessin et de la couleur dans Composition, 1916. Quoi qu'il en soit, c'est dans Composition avec lignes noires (1917, Musée Kröller-Müller, Otterlo) que Mondrian, tirant la leçon de son travail des deux années précédentes, basculera définitivement dans l'abstraction. Non seulement ce tableau ne fait plus référence à une quelconque réalité naturelle, mais toute perception gestaltiste d'une figure est rendue impossible : le plan blanc sur lequel s'essaime la résille apparemment aléatoire des bâtonnets, carrés et croix noirs et gris, est optiquement happé par les relations géométriques diffuses qu'entretiennent virtuellement ces éléments discrets entre eux, la « figure » n'est pas tracée sur un support neutre et originellement vide, elle est construite comme une incorporation, comme une destruction visuelle de l'identité de ce support. La grille Dès lors, les choses vont aller très vite pour Mondrian. Sous l'influence de Bart Van der Leck, il introduit le plan de couleur primaire dans son vocabulaire plastique (où figurait déjà le bâtonnet noir), mais, n'ayant pas encore trouvé le moyen d'articuler entre eux ces divers éléments, il les lie par le biais d'un dynamisme optique fondé sur leur superposition, ce qui a pour conséquence immédiate de faire optiquement reculer le fond (Composition avec plans de couleur A et B, 1917) et de contredire à cette donnée essentielle de la démarche du peintre, la reconnaissance de la surface du tableau. Dans les cinq Compositions avec plan de couleur datant aussi de 1917, toute superposition est éliminée, mais aussi toute « ligne ». Dans les deux dernières toiles de cette série, le « fond » lui-même est divisé intégralement en plans de différents blancs et les rectangles colorés, moins nombreux, sont en voie d'alignement. Malgré cela, les rectangles flottent encore et en conséquence le fond se creuse derrière eux : c'est là que la structure linéaire qui est la marque personnelle de Mondrian apparaît pour la première fois, dans Composition : plan de couleur avec lignes grises de 1918 (coll. Max Bill, Zurich) et deux autres œuvres aujourd'hui perdues. Il n'y a plus de « fond » blanc, et les rectangles, plus alignés encore que précédemment, sont tous délimités par des lignes grises. Ces toiles ressemblent tant aux œuvres plus tardives du néo-plasticisme, postérieures à 1920, qu'on les a souvent mal datées, mais, bien que les plans blancs ou gris, moins nombreux que les autres, ne puissent être tenus pour le « fond » du tableau, les rectangles flottent toujours, « s'individualisent » encore. C'est à ce point que Mondrian introduit la grille modulaire all-over (dans neuf toiles de 1918-1919), grille qui a l'avantage de diminuer ou plutôt d'égaliser tout contraste, de prévenir toute individualisation, et d'abolir définitivement l'opposition figure/fond. Mais là encore cette abolition même, loin d'accentuer la planéité du tableau, néantise la surface d'inscription sous un pilonnage incontrôlable d'oscillations optiques dues à la multiplication des lignes et des croisements, recrée un effet de profondeur illusoire, là où le but était d'en interdire la possibilité. De retour à Paris au printemps de 1919 (il y restera jusqu'en 1938, son atelier de la rue du Départ devenant un haut lieu de pèlerinage de l'avant-garde artistique européenne), Mondrian abandonne peu à peu la grille modulaire ; il lui faudra deux ans pour l'enterrer tout à fait, et toutes les œuvres de 1920, à l'exception du dernier tableau peint cette année, que l'on peut considérer comme le premier tableau néo-plastique (Composition avec rouge, jaune et bleu, Stedelijk Museum d'Amsterdam), sont le produit de ce lent travail de renoncement. Pourquoi Mondrian y fut-il conduit, alors que la grille modulaire semblait de prime abord répondre par excellence au but qu'il s'était assigné ? Parce qu'elle ne remplit pas la fonction pour laquelle il l'avait convoquée (camper, une fois pour toute et sans hiérarchie, la surface dans son intégrité) et parce qu'elle exalte le rythme, la répétition, c'est-à-dire le « naturel », le particulier. C'est de ce double refus qu'est né le principe du néo-plasticisme qui demeurera inchangé jusqu'aux années 1930, et dont Mondrian conçoit sa peinture comme un pâle reflet. Le néo-plasticisme Le principe du néo-plasticisme, que Mondrian nomme aussi « principe général de l'équivalence plastique », est une manière de dialectique imitée grossièrement de Hegel qui ne concerne pas seulement les arts plastiques ni même les seuls arts, mais toutes les activités de l'homme, ses productions culturelles, sa vie sociale et même sexuelle. C'est un dualisme dont le but est de dissoudre toute particularité, tout centre, toute hiérarchie : toute harmonie qui n'est pas double, constituée par une « opposition équivalente », n'est qu'apparence. Tout ce qui n'est pas « déterminé par son contraire » est « vague », « individuel », « tragique ». Au rejet de la grille fait suite un certain retour à ce qu'on pourrait nommer une forme de composition traditionnelle (équilibrage des éléments picturaux dans un tout non hiérarchique). Les textes de Mondrian à cette époque parlent de repos universel, de balance absolue, et rêvent d'une société future, parfaitement équilibrée, où chaque élément sera « déterminé ». On peut en sourire aujourd'hui, mais ces textes font comprendre pourquoi Mondrian se crut obligé d'élaborer toute une utopie architecturale (prédisant la fin de l'art dans l'architecture-en-tant-qu'environnement) : dans sa lutte contre le « particulier », Mondrian ne peut que souhaiter la fusion généralisée (de la toile avec l'intérieur de la maison qu'il faudra lui aussi considérer comme une forme d'« art », c'est-à-dire comme un tout abstrait non hiérarchisé, de l'intérieur avec la maison tout entière, de celle-ci avec la rue, de la rue avec la ville, etc.). Chacune des toiles néo-plastiques de Mondrian est considérée par lui comme un « substitut de l'ensemble », comme un modèle théorique et microcosmique d'un macrocosme à venir. La peinture a été réduite à un ensemble d'éléments incompressibles, « universels » (les plans de couleur primaire qui s'opposent aux plans de non-couleur – gris, noir, blanc ; les lignes verticales qui s'opposent aux lignes horizontales tout en arraisonnant les divers plans qu'elles délimitent à la surface de la toile), et ces éléments sont indéfiniment combinés en totalités indépendantes devenues le chiffre d'un univers d'où tout mouvement a été banni. Le rythme Après plusieurs années durant lesquelles Mondrian affine son système compositionnel, une transformation importante apparaît avec la découverte du jazz américain (qu'il conçoit comme une sorte d'équivalent musical au néo-plasticisme pictural) ; le rythme, qui était banni de son appareil théorique, est désormais doté d'une valeur positive : non limité, non formel, le « rythme libre » du jazz est universel (non particulier). Par un tour de passe-passe théorique, Mondrian dissocie encore le rythme de la répétition qui demeure « individuelle » (oppression de la machine ou limitation biologique). Au début des années 1930, l'immobilité du repos (dès lors associée à la symétrie mais aussi à la « similitude », c'est-à-dire à la répétition) est peu à peu écartée au profit de la notion d'« équilibre dynamique ». Traduction plastique immédiate : les lignes, considérées jusqu'alors comme secondaires par rapport aux plans, ayant pour seule fonction de les « déterminer », deviennent l'élément le plus actif de la composition. Mondrian en vient à donner à la ligne une fonction destructrice. Le croisement multiplié des lignes anéantit l'identité statique, monumentale, des plans, les abolit en tant que rectangles, en tant que formes. La prochaine étape sera d'abolir la ligne elle-même en tant que forme par des « oppositions mutuelles », ce qu'il essaiera explicitement de faire dans ses œuvres new-yorkaises (ayant quitté Paris pour Londres en 1938, il vit à New York les dernières années de sa vie, d'octobre 1940 à février 1944). Mais cette ultime destruction n'aura été possible qu'une fois pleinement acceptée la possibilité de la répétition, et l'acception de cette possibilité dont le bannissement avait été au départ du néo-plasticisme débouche sur une autre transformation radicale de l'appareil théorique de Mondrian : la découverte de la nécessité de la destruction de l'entité « surface ». Loin cependant d'en revenir simplement aux oscillations optiques qui perturbent notre perception des toiles modulaires de 1919, Mondrian imagine un autre moyen de prévenir notre appréhension gestaltiste de la surface du tableau : un tressage en épaisseur de bandes colorées dont nous ne pouvons plus maîtriser visuellement la complexité. Les dernières toiles new-yorkaises de Mondrian, y compris le Victory Boogie Woogie inachevé (1944, collection Mr. and Mrs. Burton Tremaine, Meridan, Conn.), dont il compliqua à souhait la structure une semaine avant sa mort, sont l'exploration de cette ultime possibilité, offrant au spectateur le vertige aporétique d'une profondeur plate qui a pour charge de « libérer notre vision ». Une entreprise picturale aura rarement été menée selon une logique aussi implacable, avec une conscience aussi aiguë des enjeux en question. Lorsque son ami Carl Holty demanda à Mondrian, qui travaillait à son dernier tableau, pourquoi il s'acharnait, tel Pénélope, à détruire le lendemain ce qu'il avait achevé la veille, celui-ci répliqua : « Ce ne sont pas des tableaux que je veux, je veux seulement découvrir des choses. » Œuvres Cette liste est incomplète ou mal ordonnée. Votre aide est la bienvenue ! Jeune fille écrivant 1890 Église de village 1898 Moulin au bord de l’eau vers 1900 Le long de l'Amstel 1903 Ferme de Nistelrode vers 1904 Paysage du soir 904 Arbre rouge 1908 Dévotion 1908 Moulin au soleil 1908 Dune V 1909-1910 Arbre argenté 1910 Tour de l’Église de Domburg 1910 Pommier en fleurs 1912 Pommier en fleurs 1912 La nature morte au pot de gingembre 1912 Composition ovale aux couleurs claires 1913 Composition no 7 1913 Composition dans l’ovale 1913 Jetée et océan : Mer et ciel étoilé 1915 Compostions no 3 avec plan colorés 1917 Autoportrait 1918 Composition, plan colorés aux contours gris 1918 Composition losange aux lignes grises 1919 Composition avec grand plan rouge, jaune, noir, gris et bleu 1921 au Musée municipal de La Haye Composition A 1923 Composition II en rouge, bleu et jaune 1930 Composition C n°III with red, yellow and blue 1935 Composition en blanc, rouge et jaune 1936 au Musée d'art du comté de Los Angeles Composition avec jaune, bleu et rouge 1937-1942 à la Tate Modern New York City 1941-1942 Broadway Boogie-Woogie 1942-1943 Composition avec lignes Victory Boogie Woogie 1944 Bois près d’Oele Composition no.12 avec du bleu 1936-1942 Expositions Aucune grande exposition couvrant la période abstraite de son œuvre n’avait été organisée en France depuis celle présentée au musée de l'Orangerie en 1969. La dernière rétrospective sur Piet Mondrian, centrée sur la période 1892 - 1914, n'a permis d'appréhender que son œuvre avant l'abstraction. Elle fut présentée au musée d’Orsay au printemps 2002. Piet Mondrian, les années parisiennes, et De Stijl l'ont été au Musée National d’Art Moderne, Centre Pompidou, du 1er décembre 2010 au 21 mars 2011.    [img width=600]http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRLE2fYEpO0SbqICtXVZzN3yWvFKykKqOSOYeXlz_WW80oGE3CiWuTz7WTm[/img]    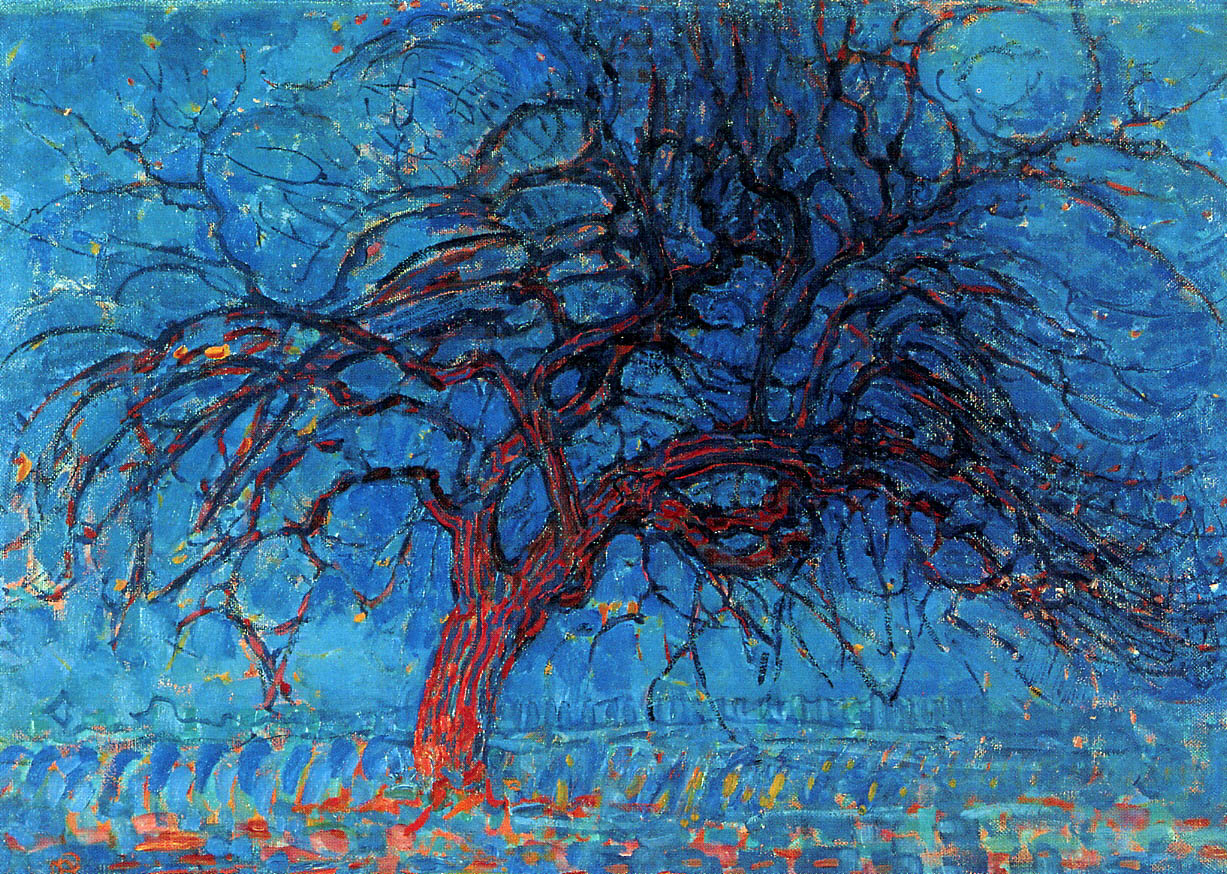       
#362
John Ruskin
Loriane
Posté le : 07/02/2015 14:37
Le 8 février 1819 naît John Ruskin à Bloomsbury en Londres
mort le 20 janvier 1900 à Coniston, Cumbria écrivain, poète, peintre et critique d'art britannique. Fils unique d'une riche famille, il fut éduqué à domicile, avec une insistance particulière sur l'art et la religion. Il poursuivit son éducation en dilettante, en tant qu'auditeur libre à Oxford. Malgré des problèmes de santé, il y obtint son MA en 1843. Surtout, il s'y lia d'amitié avec nombre d'intellectuels. Il fut publié dès son adolescence. Grâce à la fortune de sa famille, il put consacrer sa vie à l'écriture. Il devint rapidement célèbre dans les années 1840 grâce à son travail de critique Modern Painters 1843 à 1860 où il proposait une nouvelle façon d'appréhender l'art. Il écrivit ensuite The Seven Lamps of Architecture en 1849 et surtout The Stones of Venice en 1853. Il fit aussi passer ses idées par l'enseignement. Il participa à la création de l'University Museum, donna des cours de dessin au Working Men's College, un établissement de formation continue fondé par ses amis socialistes chrétiens. Il en donna aussi dans une école pour jeunes filles et par correspondance. En 1870, il devint le premier titulaire de la chaire Slade à Oxford. Son mariage avec Effie Gray annulé pour non-consommation continue à alimenter de nos jours des légendes nombreuses et variées, des suppositions. Effie épousa très vite le peintre John Everett Millais, un membre du mouvement préraphaélite dont Ruskin fut le mécène et le soutien après s'être engagé pour Turner. En bref Écrivain, critique d'art et réformateur social, Ruskin eut une influence considérable sur le goût de l'Angleterre victorienne et s'opposa aux doctrines économiques de l'école de Manchester. Dans ses ouvrages sur l'économie, la violence et l'amertume sont souvent comparables à celles de Swift. Ses réflexions sur l'art furent accueillies avec enthousiasme et respect ; sa critique sociale souleva, en revanche, une réprobation mêlée de crainte. Professeur d'art à Oxford, il partagea son temps entre l'enseignement et le mécénat. La sensibilité de Ruskin trouve son expression dans un style solennel et orné, aux cadences oratoires. De puissantes affinités électives unissaient Ruskin à Proust, qui traduisit La Bible d'Amiens et Sésame et les lis. Proust décrit ainsi l'effet décisif de la révélation de Ruskin sur sa propre conception de l'art et de la vie : « Mon admiration pour Ruskin donnait une telle importance aux choses qu'il m'avait fait aimer qu'elles me semblaient chargées d'une valeur plus grande même que celles de la vie.La révolution romantique, qui a donné à l'Angleterre son art moderne, s'est accomplie, pour l'essentiel, avant Ruskin ; mais c'est lui qui en a dégagé la signification. Composés, les plus importants du moins, entre 1840 et 1860, ses écrits sur l'art dégagent clairement et imposent la notion même d'un art moderne. Ils le dotent rétrospectivement d'une conscience esthétique et morale. Cette activité spéculative ne se présente pas d'un seul bloc. Même dans les deux décennies où Ruskin s'est consacré presque uniquement à l'étude de l'art, sa pensée a beaucoup évolué. Commencés en 1842 mais achevés en 1860 seulement, les cinq volumes de Modern Painters en présentent les états successifs plutôt qu'ils n'en constituent la somme. Les contradictions apparentes abondent ; les grands développements s'articulent mal, et cela est d'autant plus déroutant que le détail de l'argumentation emprunte souvent à la littérature didactique et morale sa démarche logique et jusqu'à sa rhétorique propre. Cependant, l'essentiel de la méditation de Ruskin sur l'art s'organise autour de quelques données permanentes, constantes d'une sensibilité et postulats d'une pensée. "Je possède, écrit-il, un instinct puissant, et que je ne peux analyser : celui de voir et de décrire les choses que j'aime. " Par cet instinct, par une perception extraordinairement aiguë et complète, le tempérament personnel de Ruskin s'accorde au génie objectif qu'avaient légué à l'Angleterre romantique des siècles de tradition rurale. La génération contemporaine de la Révolution et de l'Empire venait de doter cette tradition d'un statut théorique et d'un somptueux répertoire de thèmes et de motifs. Ruskin la recueille à son tour. L'art, selon lui, a pour objet de voir et de décrire ce qui est. Lui en assigner un autre revient à le pervertir, et sa grandeur est en quelque sorte relative à sa vérité. Le concept de vérité occupe une place centrale chez Ruskin, et par lui son réalisme instinctif s'approfondit en réflexion morale. Car la vérité ne se réduit nullement à une ressemblance matérielle : elle implique l'engagement sincère de l'artiste dans ce qu'il représente, son refus de tricher, de s'en remettre au savoir-faire, à l'expérience d'autrui ou à des idées générales. Cette exigence rejoint celle que formulent, dans les mêmes années, les écrits esthétiques de Baudelaire, avec leur condamnation du chic et du poncif et leur éloge de la naïveté. Elle est caractéristique d'une époque où l'art, comme la société, abdique ses valeurs morales sous la marée montante du matérialisme. Une grande part de l'activité critique de Ruskin consiste donc à confronter les œuvres d'art et cette nature dont elles se prétendent l'image et qu'il a si bien observée lui-même. Il condamne implacablement la tradition classique, qui aurait prétendu ramener la variété de la nature à l'unité d'un grand style ; mais il rejette aussi le naturalisme du XVIe siècle, qui voulut trop, à ses yeux, nier la nature spirituelle de l'homme au profit de sa nature physique et de la beauté en soi. Son idéal personnel consiste en un art qui se donne pour unique objet les choses telles qu'elles sont, et accepte également, dans chacune d'elles, le bien et le mal . Ce programme lui paraît accompli par le paysage moderne. Ruskin propose de désigner le caractère dominant de cet art par le mot cloudiness, nuageosité. Les nuages ne sont pas seulement pour le peintre des sujets de prédilection, mais les symboles d'une nature en perpétuelle métamorphose. Pour en saisir la vérité, l'artiste moderne suit donc la démarche opposée à celle du paysagiste classique. Il se refuse à sacrifier les vérités particulières à un beau idéal ; il cherche à retrouver les rythmes organiques de la nature et les conditions de la perception. Sa vie John Ruskin était le fils unique de John James Ruskin, 1785 – 1864 et de Margaret Cox ou Cock, 1781 – 1871. Les époux étaient cousins germains. Les deux familles pratiquaient le commerce de l'alcool. Le grand-père maternel de John Ruskin avait un pub à Croydon. Son grand-père paternel, John Thomas Ruskin, 1761 – 1817, originaire d'Édimbourg avait migré d'Écosse à Londres pour s'installer comme marchand. Le père de John Ruskin, quant à lui, était importateur de sherry. Il commença par solder les dettes de l'entreprise familiale avant de faire fortune dans la société Ruskin, Telford, and Domecq. Les parents de John Ruskin s'étaient fiancés en 1809, mais les dettes familiales et l'opposition parentale avaient retardé le mariage. En 1817, John James Ruskin était riche et ses parents étaient morts, il semblerait que son père se fût suicidé peu de temps après le décès de son épouse. La noce se déroula en 1818. John Ruskin naquit l'année suivante, dans la maison familiale donnant sur Brunswick Square dans Bloomsbury, un des beaux quartiers de Londres. En 1823, la famille déménagea pour Herne Hill. Dans ses Præterita, John Ruskin décrit une enfance assez solitaire, mais heureuse. Éducation Jusqu'à ses quatorze ans, John Ruskin fut éduqué à domicile, soit par ses parents, soit par des précepteurs. Son père lui fit passer son intérêt pour le romantisme Walter Scott, Lord Byron ou Wordsworth. John James Ruskin avait dû arrêter ses études avant l'université où il avait désiré faire du droit, pour se mettre à travailler. Il semblerait qu'il ait tenté de se consoler de la frustration qu'il avait ressentie alors en permettant à son fils de faire ce qui lui plaisait. Le jeune John était encouragé par son père à dessiner et à écrire. Chacun de ses poèmes lui était ainsi payé un demi-penny le vers. Dès ses douze ans, il avait entrepris d'écrire un dictionnaire, manuscrit, de minéralogie. Sa mère lui donna une stricte éducation religieuse, de tendance évangélique. Dès ses trois ans, elle lui faisait lire des passages de la Bible tous les matins. Il en apprit aussi par cœur. Cette éducation eut des conséquences sur le reste de la vie de John Ruskin. Elle lui fournit la base de ses réflexions aussi bien littéraires que juridiques. Il semble que le puritanisme fut à l'origine de son attrait sensuel pour l'art et de son rejet des choses du corps. Dès le début, cette éducation fut complétée de deux façons. D'abord, ses parents lui firent régulièrement visiter les hauts-lieux culturels de Grande-Bretagne : paysages ou demeures célèbres. À partir de 1833, ces voyages furent élargis au continent, France, Suisse puis Italie. Dès lors, entre deux voyages, il passa ses matinées dans une école proche de chez lui, tenue par le révérend Thomas Dale. Au début de 1836, alors que ce dernier était devenu professeur de littérature britannique au King's College de Londres, Ruskin commença à y suivre des cours. En octobre de la même année, il s'inscrivit au Christ Church, Oxford en tant qu'auditeur libre. Il suivit les cours à partir de janvier de l'année suivante. Il ne quitta cependant pas le giron familial car sa mère vint s'installer à Oxford, rejointe par son époux tous les week-ends. Elle disait qu'elle était venue pour veiller sur la santé fragile de son fils. À la différence de nombre de ses condisciples, John Ruskin passait son temps dans les livres, ce qui lui valut l'animosité de certains. Il devint cependant rapidement proche des spécialistes de lettres classiques, comme Charles Thomas Newton, mais aussi des géologues comme Henry Acland ou Henry Liddell. Ruskin attira l'attention du géologue et théologien William Buckland pour les cours duquel il fournit des dessins. Il adhéra aussi à l’Oxford Society for the Preservation of Gothic Architecture et se présenta au prix Newdigate de poésie qu'il finit par remporter lors de sa troisième tentative en 1839. Ce fut Wordsworth lui-même qui lui remit son prix. Cependant, ce furent ses dernières productions poétiques. À l'automne 1839, ses professeurs lui suggérèrent de se présenter en candidat libre aux examens de baccalauréat. Il était amoureux d'Adèle Domecq, fille d'un des partenaires dans la firme paternelle. Quand il apprit son mariage en avril 1840, il se mit à tousser du sang et dut renoncer à passer ses examens. Il ne put se présenter qu'en avril 1842. L'université lui accorda alors un diplôme honoraire. Il obtint cependant son MA en octobre 1843 ce qui lui permit de signer ses premiers ouvrages d'un Graduate of Oxford, diplômé d'Oxford. Voyages sur le continent et les Modern Painters Pendant sa convalescence, en 1840-1841, John Ruskin voyagea avec ses parents en Italie, principalement à Naples et Rome. Dans cette dernière ville, il fit la connaissance du peintre Joseph Severn, un ami de John Keats. Severn épouserait plus tard Joan Agnew Ruskin, une cousine de John Ruskin. Il veillerait sur les derniers jours de celui-ci. Il rencontra aussi le peintre George Richmond qui lui fit découvrir les peintres italiens et que Ruskin consulterait à de nombreuses reprises lors de sa rédaction de ses Modern Painters. L'année suivante, la famille Ruskin se rendit en Suisse avant de descendre le Rhin. Au cours de ce séjour, John Ruskin eut l'idée d'écrire un pamphlet de critique artistique. Le premier tome de Modern Painters: their Superiority in the Art of Landscape Painting to the Ancient Masters parut en mai 1843, le second en 1846, le quatrième en 1856. Le cinquième tome parut en 1860. En 1845, il voyagea pour la première fois sans ses parents, en Suisse, en Italie : Florence, Pise et Venise où il découvrit les primitifs italiens, Fra Angelico et le Tintoret, dont ses œuvres à la Scuola Grande de San Rocco, ainsi qu'en France où il passa beaucoup de temps au Louvre. À Venise, Ruskin observa que la ville subissait les assauts délétères de deux forces opposées : la restauration et le délabrement. Ce voyage nourrit le deuxième tome de ses Modern Painters. Les deux premiers tomes furent appréciés par Charlotte Brontë, Wordsworth ou Elizabeth Gaskell, mais la critique établie, comme George Darley dans The Athenaeum fut moins favorable. Malgré tout, la carrière littéraire de Ruskin était lancée. Il entra dans les cercles littéraires de Richard Monckton-Milnes ou Samuel Rogers. Intérêt pour l'architecture Son voyage en Italie lui avait fait découvrir la beauté et le délabrement des monuments romans et gothiques de ce pays. De retour en Grande-Bretagne, il se tourna vers l'étude de l'architecture, principalement celle du Gothic Revival. Dès 1844, il avait travaillé avec l'architecte George Gilbert Scott à la restauration d'une église de Camberwell. Avec un de ses anciens condisciples, Edmund Oldfield, Ruskin en dessina un des vitraux. À l'été 1848, il visita la cathédrale de Salisbury puis à l'automne les églises de Normandie. Cependant, ce voyage, qui était aussi son voyage de noces, n'alla pas plus au sud à cause des événements parisiens et surtout vénitiens. De ses réflexions et voyages, naquit en mai 1849 The Seven Lamps of Architecture, le premier ouvrage à être ouvertement signé John Ruskin. En 1849, Edmund Oldfield était présent avec Ruskin à la fondation de l'Arundel Society. En 1853, George Gilbert Scott fit appel aux lumières de Ruskin lors de son réaménagement dans le style roman d'une église de Camden. Legs Turner À la fin de 1851, le célèbre artiste aquarelliste William Turner mourut. Ruskin qui en avait été très proche devint son exécuteur testamentaire. Cependant, la tâche se révéla rapidement insurmontable. Il découvrit aussi des aspects sombres de l'artiste qu'il ne soupçonnait pas. Lorsque la succession fut définitivement réglée, toutes les œuvres de William Turner rejoignirent la National Gallery en 1856. L'atelier du peintre recelait plus de 20 000 aquarelles. Ruskin obtint le droit d'en exposer 400, de son choix, dans des salles qu'il dessina et fit aménager lui-même dans la National Gallery. Il se chargea aussi de publier des catalogues de ces œuvres. Certains des dessins et esquisses de l'artiste avaient un caractère pornographique dont la possession même aurait pu être illégale. Ruskin donna son accord pour qu'elles soient détruites. Mariage annulé John Ruskin épousa Euphemia Chalmers Gray, dite Effie Gray, le 10 avril 1848, à Perth en Écosse. Elle était la fille de George Gray, avocat ami de la famille. Les futurs époux s'étaient rencontrés quand elle avait douze ans et lui vingt-et-un. En 1841, elle lui avait demandé de lui écrire un conte de fées. The King of the Golden River fut la seule œuvre de fiction et un des principaux succès littéraires de Ruskin, après sa parution en 1850 avec des illustrations de Richard Doyle. Ce ne fut que lorsque la jeune fille eut dix-neuf ans que Ruskin la remarqua au cours d'un de ses voyages en Écosse pour soigner une nouvelle dépression. Il se remettait de ses sentiments pour Adèle Domecq, puis pour Charlotte Lockhart, petite-fille de Walter Scott et fille de John Gibson Lockhart. Ruskin décida qu'il était amoureux d'Effie Gray et lui fit un peu la cour. Cependant, sa demande en mariage et la réponse positive se firent au cours d'un échange de lettres après son retour à Londres. Les parents de Ruskin ne s'opposèrent pas au mariage, mais n'y assistèrent pas. Il se déroula en effet à Bowerswell, résidence de la famille Gray, à Perth. Cette maison avait été auparavant celle des Ruskin où le grand-père s'était suicidé. La nuit de noces se déroula à Blair Atholl et le voyage de noces, prévu à Venise s'arrêta en Normandie à cause des événements politiques de 1848. Dans une lettre à son père en 1854, Effie Ruskin, décrit le fiasco de la nuit de noces. Elle y confie son ignorance quant aux relations sexuelles et écrit que Ruskin « avait été dégoûté par mon corps le premier soir ». Cette phrase donna lieu à de nombreuses spéculations et légendes. La principale est que Ruskin aurait été écœuré par la découverte des poils pubiens de son épouse, car, esthète, il n'aurait jamais vu que des nus artistiques. Or, il semblerait qu'il ait eu accès, grâce à ses condisciples d'Oxford, à des images érotiques et pornographiques l'ayant informé sur cet aspect. Une autre hypothèse aurait été qu'Effie aurait eu ses règles ce soir-là. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que les deux époux seraient convenus de repousser la consommation de leur mariage jusqu'aux vingt-cinq ans d'Effie, au moins, afin d'être libres de voyager, ce qu'ils désiraient ardemment tous deux, sans être dérangés par une ou plusieurs maternités. Après le voyage de noces, les époux s'installèrent chez Ruskin, qui vivait toujours chez ses parents. Il se replongea dans ses travaux intellectuels et ne fut pas un époux très attentionné. Les relations entre Effie Ruskin et ses beaux-parents se dégradèrent rapidement. Elle tomba malade et retourna chez ses propres parents au début de l'année 1849. Les époux ne se virent pas pendant neuf mois. Il finit par aller la rechercher en Écosse et ils partirent, enfin, pour Venise. Ils y séjournèrent longuement en 1849-1850, passèrent onze mois à Londres, mais pas dans la maison familiale, puis retournèrent à Venise en 1851-1852. Cette période fut la plus heureuse de la vie du couple. Éloignés de leurs familles respectives, il pouvait travailler et elle entretenir une véritable vie mondaine, autant à Venise qu'à Londres. Ils fréquentaient la bonne société dans l'une et l'autre ville. À Londres, ils allaient régulièrement chez Charles Lock Eastlake, président de la Royal Academy. Ruskin n'appréciait pas ses tableaux, mais les deux femmes étaient amies. À cette époque, Ruskin fit la connaissance du socialiste chrétien F. D. Maurice. Ce fut enfin le poète Coventry Patmore qui présenta le couple Ruskin au cercle préraphaélite où ils rencontrèrent John Everett Millais. John Ruskin se fit rapidement le mécène et le champion de celui-ci, ainsi que de John Frederick Lewis. The Order of Release par John Everett Millais : tableau exposé à la Royal Academy en 1853 et pour lequel Effie Ruskin avait posé. Un nouveau séjour à Venise se termina mal : les bijoux d'Effie avaient été dérobés. Un officier britannique de l'armée autrichienne fut soupçonné. Il semblerait que John Ruskin ait alors dû refuser de se battre en duel. De retour à Londres à l'été 1852, le couple s'installa chez lui, d'abord à Herne Hill puis à Mayfair. Si les parents de Ruskin n'habitaient pas avec eux, leur présence se faisait cependant pesante : ils ne cessaient de critiquer le train de vie que, selon eux, Effie imposait. Et puis Effie se rendit à l'évidence : son époux ne consommerait jamais leur mariage. Elle en conçut une frustration de plus en plus grande. Au printemps 1853, Millais présenta à l'exposition annuelle de la Royal Academy son Order of Release pour lequel Effie avait posé. Ruskin réitéra l'invitation qu'il avait déjà faite à Millais de passer des vacances avec eux. Le groupe d'amis séjourna tout l'été en Écosse. Millais commença le portrait en pied que son mécène lui avait commandé. Il fit aussi diverses esquisses d'Effie en vue d'un tableau qu'il ne réalisa jamais. Ruskin continuait son travail solitaire : la préparation d'une série de conférences pour l'automne à Édimbourg. Livrés à eux-mêmes, Millais et Effie finirent par succomber à l'amour. Le 25 avril 1854, John Ruskin fut cité à comparaître devant la Commissary Court du Surrey. L'audience se tint le 15 juillet 1854, en son absence, il était à Chamonix avec ses parents et sans qu'il y fût représenté et défendu. Elle prononça l'annulation du mariage pour non-consommation en raison d'une impuissance incurable ». La non-consommation avait été constatée : un examen médical avait confirmé qu'Effie était toujours vierge. Cependant, Ruskin défendit, en privé, sa virilité, se proposant même de la prouver. La preuve physique ne fut cependant pas exigée. À la même occasion, il expliqua qu'il était parfaitement capable de consommer son mariage, mais qu'il n'aimait pas assez Effie pour en avoir envie. Effie Gray épousa Millais le 3 juillet 1855 et ils eurent huit enfants. Soutien aux préraphaélites Le premier engagement de Ruskin en faveur des préraphaélites remontait à l'été 1851 quand leurs tableaux exposés à la Royal Academy furent vivement attaqués par la critique. Millais se tourna alors vers son ami Coventry Patmore, qui connaissait Ruskin, pour lui demander d'essayer d'obtenir l'aide de ce dernier. Ruskin répondit favorablement et envoya deux lettres au Times. La défense n'était cependant pas exempte de critiques : Ruskin n'appréciait pas les aspects un peu trop high church du christianisme exprimé dans leurs tableaux, et le disait. Ruskin et Millais devinrent dès ce moment-là amis et le critique invita déjà le peintre à venir passer des vacances avec lui et sa femme. Un pamphlet intitulé Pre-Raphaelitism suivit dès août 1851. S'il parlait plus de Turner, son propos présentait cependant les préraphaélites comme les héritiers et continuateurs du vieux peintre, car comme lui ils poursuivaient la vérité visuelle et imaginaire. Le cycle de conférences donné à Édimbourg début 1854, et publié l'année suivante sous le titre Lectures on Architecture and Painting, porta principalement sur l'architecture gothique et sur le courant préraphaélite. À l'été 1854, Ruskin défendit les deux tableaux présentés à la Royal Academy par William Holman Hunt dans deux lettres au Times. Son soutien n'était cependant pas qu'intellectuel, en tant que critique d'art : il était aussi acheteur ou mécène, il acheta ou commanda dès 1853 des dessins à Dante Gabriel Rossetti ou à Elizabeth Siddal et conseiller auprès d'autres acheteurs de la bonne société britannique. John Ruskin apporta un soutien financier parfois direct aux artistes préraphaélites : en 1855, il fit une rente à Elizabeth Siddal et l'envoya consulter son ami Henry Acland devenu professeur de médecine à Oxford. Comme les œuvres préraphaélites incarnaient l'idéal esthétique prôné par Ruskin, il se considéra aussi très vite membre à part entière de la PRB PreRaphaelite Brotherhood, confrérie préraphaélite. Il fut d'ailleurs admis au Hogarth Club et aida à monter une exposition. Cependant, comme il était plus âgé que les préraphaélites, à peu près dix ans, ils le considéraient plutôt comme un oncle riche et finançant que comme un frère à part entière. Sa rupture avec Millais suite à ses problèmes conjugaux avait en plus divisé le groupe. Il se rapprocha un temps de Dante Gabriel Rossetti, au point d'envisager d'habiter le même immeuble que celui-ci après la mort de son épouse Elizabeth Siddal. Il semblerait cependant que le mode de vie de bohème de Rossetti ait déplu à Ruskin qui trouvait aussi ses tableaux de plus en plus morbides. Leur amitié n'existait plus au milieu des années 1860. Ruskin joua aussi un rôle dans l'idéologie préraphaélite. Ses Stones of Venice furent déterminantes pour William Morris et Edward Burne-Jones qui les découvrirent alors qu'ils n'étaient encore qu'étudiants à Oxford, mais aussi pour Millais ou William Holman Hunt. L'annulation de son mariage avait permis à Ruskin de se replier chez lui, n'ayant plus à accompagner son épouse dans le monde. Il continua cependant à fréquenter quelques amis comme Carlyle, Alfred, Lord Tennyson, Coventry Patmore, William Allingham, Robert et Elizabeth Browning ou James Anthony Froude et surtout à entretenir une abondante correspondance. Ainsi, il correspondit longuement avec le critique américain Charles Eliot Norton, qui diffusa ses idées aux États-Unis. Celui-ci devint même responsable de la gestion de son œuvre littéraire après sa mort. Il brûla la quasi-totalité de ce qui avait trait à Rose La Touche. Implication dans le Working Men's College Dans les années 1850, John Ruskin apporta un soutien direct à diverses initiatives pédagogiques, voire d'éducation populaire. Son ami Henry Acland avait développé l'University Museum comme il était alors appelé, à Oxford. Ruskin rencontra l'architecte Benjamin Woodward et fut en partie responsable du style néo-gothique adopté. Il fut aussi essentiel dans le choix de l'ornementation pour laquelle il proposa des croquis et suggéra de faire appel aux sculpteurs préraphaélites Alexander Munro et Thomas Woolner. Enfin, il organisa la levée de fonds pour financer la construction. Ruskin vint aussi régulièrement faire des conférences sur l'esthétique aux ouvriers sur le chantier. Après la mort de l'architecte et le retard pris dans l'achèvement des décors, il finit cependant par se désintéresser du projet. Son amitié avec F. D. Maurice le fit s'intéresser à l'initiative de celui-ci et d'autres socialistes chrétiens, le Working Men's College, un établissement de formation continue créé à Londres. Il y donna même des cours de dessin de 1854 à 1858. Ruskin considérait qu'il n'aidait peut-être pas faire d'un charpentier un artiste, mais à le rendre plus heureux dans son métier de charpentier. Il réussit à convaincre Rossetti à venir lui aussi enseigner. Ce fut au Working Men's College que ce dernier fit la connaissance de Burne-Jones. Une crise de la quarantaine ? La plupart des biographes de Ruskin s'accordent pour dire que la fin des années 1850 et le début des années 1860 fut pour lui une période charnière : sa foi évolua tout comme son attitude vis-à-vis des peintres de la Renaissance italienne. Il se libéra un peu de l'emprise parentale et éprouva du désir sexuel. En 1858, il séjourna en Suisse et Italie, seul. À Turin, il fut frappé par l'énorme différence entre l'étroite simplicité du service et de la chapelle protestante où il suivait la messe et la grandeur des Véronèse qu'il étudiait. Il renonça même à son sabbatarianisme en dessinant le dimanche. Dans son autobiographie, il écrivit plus tard qu'il avait alors mis définitivement de côté son évangélisme. Il perdit même un temps sa croyance en une vie après la mort. Il ne devint cependant pas athée. Il évolua aussi dans ses goûts artistiques. Il délaissa le néogothique et réévalua les peintres vénitiens du XVIe siècle. Il réintégra même la Grèce antique dans son histoire de l'art occidental. Il prit alors sous son aile le jeune Edward Burne-Jones qui vint en Italie étudier les artistes de la Renaissance, financé par Ruskin dans les affections duquel il remplaça peu à peu Rossetti. Ruskin devint le parrain de Philip, le fils aîné des Burne-Jones. La famille l'accompagna lors d'un nouveau voyage en Italie en 1862. Burne-Jones fut aussi impliqué par Ruskin dans l'expérience de Winnington Hall School : il fournit des dessins pour les tapisseries à broder. Ruskin lui commanda aussi en 1863 des gravures pour illustrer son essai d'économie politique Munera pulveris. Cependant, l'amitié se refroidit à la fin des années 1860 quand le critique attaqua Michel-Ange qu'adorait l'artiste. En 1859, Ruskin et ses parents firent leur dernier voyage ensemble, en Allemagne. Il fut pénible à tous points de vue : physiquement, la santé des parents déclinait ; moralement, les différences religieuses entre la mère et le fils créèrent des tensions. Le père de Ruskin à la santé de plus en plus fragile mit alors la pression sur son fils pour qu'il terminât Modern Painters avant sa mort. En 1860, la mère de Ruskin se brisa le col du fémur. Il s'éloigna alors autant qu'il le pouvait de la résidence familiale et passa de plus en plus de temps à Winnington Hall School, une école moderne pour jeunes filles fondée par Margaret Bell à Northwich, ce qui lui fut reproché, principalement l'argent qu'il dépensait à financer cette expérience éducative. Il passa aussi beaucoup de temps à voyager sur le continent, principalement les Alpes. Il envisagea même d'y acheter une propriété, à Brizon. Seule la mort de son père en mars 1864 mit un terme à ses voyages. Il hérita de 157 000 £, d'une collection de tableaux estimée à 10 000 £ et de nombreuses propriétés, maisons et terres. Il en dépensa une partie dans divers projets philanthropiques, dont ceux d'Octavia Hill. Cette fortune allait lui permettre de continuer à vivre et à écrire sans soucis. La pression paternelle ayant disparu, il se sentait intellectuellement plus libre. Il continua à vivre avec sa mère, et une cousine, Joan ou Joanna Agnew vint s'installer avec eux comme dame de compagnie, lui facilitant la vie. Rose La Touche Ruskin donnait aussi des cours de dessin par correspondance. Parmi ses élèves se trouvaient Octavia Hill dont il finança les projets philanthropiques ou la marquise de Waterford, Louisa Beresford, une artiste proche des préraphaélites qui lui présenta la famille La Touche en janvier 1858. Riches banquiers irlandais d'origine huguenote, ils désiraient attirer Ruskin dans leur cercle social et lui demandèrent de donner des cours de dessin à leurs deux filles : Emily quatorze ans et Rose dix ans. Il devint rapidement un ami de la famille et fut régulièrement invité, soit dans la résidence londonienne, soit dans celle d'Harristown dans le comté de Kildare en Irlande. Maria La Touche, la mère, devint une confidente très proche. Ce fut à elle qu'il avoua en premier ses évolutions religieuses en août. Cependant, ce fut aussi à la même période qu'il devint évident qu'il était beaucoup plus attiré par la plus jeune des filles, Rose. Celle-ci de son côté montra ses premiers signes d'anorexie mentale. Cette situation créa des tensions. Les longs voyages continentaux de Ruskin au début des années 1860 sont souvent considérés comme une volonté d'éviter les La Touche. De 1862 à 1865, il ne revit pas Rose La Touche et celle-ci s'enfonça dans son anorexie. Quand Rose atteignit ses dix-huit ans en janvier 1866, Ruskin la demanda en mariage. Elle ne refusa pas, mais souhaita attendre encore trois ans. Les parents s'alarmèrent de ses sentiments qui s'avéraient réciproques. Les liens ne furent pas coupés, mais Ruskin dut avoir recours à des intermédiaires pour communiquer avec la jeune fille : Georgiana Cowper, l'épouse de William Cowper-Temple, une amie qu'il avait rencontrée à Rome en 1840 ; George MacDonald ; ainsi que sa cousine Joan Agnew qui était fiancée à Percy La Touche, le frère de Rose. Ainsi, il lui était interdit de la voir. Les difficultés s'accentuèrent après que Maria La Touche rencontra Effie Millais pour se renseigner sur Ruskin. En fait, elle craignait qu'une consommation du mariage entre Rose et Ruskin rendrait caduc l'arrêt d'annulation du premier mariage, faisant de Ruskin un bigame. Celui-ci consulta de son côté des avocats pour connaître ses droits. Pendant les trois ans de séparation, l'anorexie de Rose empira. Même si Rose assurait Ruskin de son amour pour lui, il semblerait que les doutes religieux qu'il exprimait eurent un effet négatif sur elle qui était dévote. En octobre 1870, sa mère lui montra les lettres qu'elle avait échangées avec Effie Millais. L'effet désiré fut atteint : Rose rompit avec Ruskin. Elle s'enfonça dans son anorexie. Quant à lui, il fit une grave dépression nerveuse et s'enfuit à Venise. L'année suivante, elle demanda une réconciliation via les intermédiaires habituels et il revint de Venise en juillet 1872. Ils passèrent ensemble quelques jours qui semblent avoir été très heureux. Cependant lorsque Ruskin reparla de mariage, elle refusa. Elle demanda à le revoir en 1873, mais ce fut à son tour de refuser. En 1874, elle vint se faire soigner à Londres et ils se virent régulièrement de septembre à décembre, malgré l'opposition des parents de Rose. Ils se rencontrèrent une dernière fois le 15 février 1875, tandis qu'elle était en fin de vie. Elle mourut de son anorexie le 25 mai 1875, plongeant Ruskin dans le désespoir. Professeur à Oxford Ruskin, fort de son expérience au Working Men's College ou à Winnington Hall School, l'école moderne pour jeunes filles fondée par Margaret Bell dans le quartier de Winnington, à Northwich, dans le Cheshire ainsi que de ses cours de dessin par correspondance, synthétisa sa méthode dans The Elements of Drawing 1857 puis Elements of Perspective (1859). Ses Laws of Fiesole restèrent inachevées. Il s'opposait à la méthode mécanique traditionnelle, insistant sur le fait que savoir voir était plus important que savoir dessiner. Il alla jusqu'à fonder sa propre école de dessin à Oxford à partir du moment où il y occupa la chaire Slade, tout juste fondée, en 1870. En 1874, il rencontre le jeune l'architecte Arthur Heygate Mackmurdo, part avec lui à Florence et le pousse à créer son agence ; il eut une grande influence sur la création de la Century Guild of Artists et sur le mouvement Arts & Crafts. Sa chaire fut si suivie qu'elle est encore surnommée la chaire John Ruskin. Fin de vie et mort Il mourut dans sa résidence de Brantwood à Coniston près du Lake District, et, conformément à son souhait, fut inhumé là, ayant refusé la place qui lui avait été offerte dans l'abbaye de Westminster. Collectionneur John Ruskin et son père furent d'ardents collectionneurs d'art. Ils acquirent de nombreuses aquarelles de Samuel Prout d'abord et à partir de 1839 de J. M. W. Turner. Les deux artistes devinrent d'ailleurs des amis de la famille et furent régulièrement reçus. Les Ruskin furent même à partir de 1842 des mécènes de Turner à qui ils passèrent nombre de commandes. En 1861, John Ruskin put donner 48 Turner à l'Ashmolean Museum d'Oxford et 25 au Fitzwilliam Museum de Cambridge. Il acheta aussi aux préraphaélites de nombreux tableaux, dessins ou gravures. Œuvres John Ruskin fut très tôt publié. Ses premiers poèmes parurent dès août 1829 dans le Spiritual Times. En 1834, plusieurs de ses travaux géologiques furent publiés par John Claudius Loudon dans son Magazine of Natural History. De même, une première version de The Poetry of Architecture éditée en 1893 parut alors que Ruskin était étudiant à Oxford dans l’Architectural Magazine de ce même J. C. Loudon. Modern Painters La Pass of Faido 1845, étude de Ruskin, sur place, réflexion à partir de l'aquarelle commandée quelques années plus tôt à Turner. L'idée à l'origine de cet ouvrage vint à Ruskin lors de son voyage en Italie, Suisse et Allemagne au début des années 1840. Il exprima dès 1842 la volonté d'écrire un pamphlet de critique d'art afin de défendre l'œuvre de Turner à nouveau attaquée par la presse britannique. Il l'avait déjà fait en 1836, mais son texte, à la demande de Turner lui-même n'avait pas été publié. Cette fois-ci, il mena le projet à terme. Le premier tome de Modern Painters: their Superiority in the Art of Landscape Painting to the Ancient Masters, sans illustration, parut en 1843. Il fut très vite réédité, connaissant une troisième édition dès 1846. Le deuxième tome parut la même année, après un nouveau voyage en Suisse, Italie en France. Le cinquième et dernier tome parut en 1860. Le premier tome insiste sur la vérité en art. Celle-ci n'est pas, selon Ruskin, factuelle, mais morale. L'important pour lui est la véritable perception d'un paysage et non son interprétation via la norme des conventions artistiques du pittoresque mises en place par les maîtres italiens et hollandais des XVII et XVIIIe siècles. L'idéal pour Ruskin est alors le travail de Turner, le seul capable de peindre une montagne, ou une pierre. S'il défend Turner, il ne critique cependant pas encore les peintres de son époque. Le ton change avec le second volume, après son voyage à Venise et la lecture en chemin de l'ouvrage d'Alexis Rio De la poésie chrétienne dans son principe, dans sa matière, et dans ses formes paru en 1836. Pour Ruskin alors, la véritable perception de la nature est une expérience mystique de la beauté et donc de Dieu. Il reprend, dans une acception personnelle, le concept de faculté théorique du grec θεωρία, contemplation, observation. Cette faculté théorique agit au moment de la perception, entre l'œil et l'esprit, permettant une appréhension instinctuelle et morale de la beauté. Il l'oppose à une appréhension consciente et rationnelle. Il poursuit sa réflexion sur la beauté en la scindant en deux grands types : la beauté vitale et la beauté typique. La beauté vitale est pour lui fondée sur la théologie de la nature, elle est la volonté divine exprimée dans Sa création sous toutes ses formes, le monde et ses habitants dont l'homme. La beauté typique par contre est pour Ruskin inscrite dans la théologie évangélique : cette beauté est ressentie par l'homme quand il réagit à des grands types qui sont l'expression de l'immanence divine dans la Nature, infini, pureté, unité, symétrie, etc.. Ces types présents et dans la nature et dans l'art ne sont pas pour lui que des abstractions. Ils ont aussi une réalité que l'artiste se doit de représenter s'il veut réellement exprimer la vérité. John Ruskin développe ensuite une théorie sur l'imagination qui permet la création. Il scinde celle-ci en trois grandes formes : l'imagination pénétrante, l' imagination associative et l'imagination contemplative. La première voit et donc reproduit la forme externe et l'essence interne donc la vérité de ce que la faculté théorique observe ; la deuxième exprime à la fois la vérité et la pensée de l'artiste créée par la perception de la vérité ; la troisième transforme la vérité en symboles. Donc, pour Ruskin, l'artiste peut très bien représenter la vérité non pas par un réalisme total, mais symboliquement. La vérité artistique n'est pas naturaliste, elle peut être sublimée dans sa représentation symbolique. The Seven Lamps of Architecture The Seven Lamps of Architecture, les Sept Lampes de l'Architecture parut en mai 1849. Il fut le premier ouvrage à être signé John Ruskin. Il fut aussi le premier à être illustré : quatorze gravures de la main même de l'auteur. Dès sa préface, il se montre très clair : il attaque le restaurateur, le révolutionniste. Il refuse la restauration des bâtiments anciens qui doivent être protégés afin de servir de modèle aux architectes du temps, dont ceux du Gothic Revival. Il veut aussi que ce mouvement esthétique se sécularise et se protestantise. Il veut le protéger de la mauvaise influence du catholicisme romain, représentée selon lui par Augustus Pugin. Dans la pensée de Ruskin, les sept lampes qui éclairent l'architecte sont le sacrifice, la vérité, la puissance, la beauté, la vie, la mémoire et l'obéissance. L'ouvrage a été éclipsé par la succès des Stones of Venice, dont il peut être envisagé comme un prélude. John Ruskin s'oppose dès 1849 avec ferveur aux conceptions de l'architecte Viollet-le-Duc, pour qui l'architecture doit former un tout homogène, au mépris de l'histoire et de l'intégrité du monument. Dans les Sept Lampes de l'Architecture, Ruskin définit un monument architectural comme un ensemble organique qu'il faut soutenir en le restaurant le moins possible, mais qu'il faut aussi laisser mourir. Ainsi s'opposent deux conceptions de la restauration du patrimoine bâti. Ruskin est soutenu dans son approche par William Morris, qui prône la non-restauration dans le cadre de la Société pour la protection des bâtiments anciens. L'engagement de Ruskin contre la restauration tient souvent de la ferveur militante : on recense plus de 1 200 lettres concernant ce sujet. The Stones of Venice Membre du mouvement des préraphaélites, il est l'auteur d'un ouvrage qui le fait considérer comme le fondateur du mouvement Arts & Crafts : Les Pierres de Venise 1853. Cette œuvre a un impact non négligeable sur la société victorienne dans sa tentative de relier l'art, la nature, la moralité et l'homme, William Morris, dont Ruskin a été le mentor, est le chef de file du mouvement. Par ses écrits et son audience, par son combat pour ressusciter l'artisanat moribond au Royaume-Uni, il est un précurseur de l'Art nouveau. Critique d'art En 1878, il est poursuivi en justice pour diffamation par Whistler pour avoir condamné sa peinture le Nocturne in Black and Gold: The Falling Rocket 1874. Whistler obtient une indemnisation symbolique. Son éclectisme l'amène à apprécier aussi bien les peintres primitifs italiens que les préraphaélites britanniques ou Turner. John Ruskin : Étude de gneiss, Glenfinlas 1853, crayon, encre et lavis à l'encre de Chine sur papier, Ashmolean Museum, Oxford Sa notoriété fait de lui un remarquable propagandiste des arts. Ses idées se popularisent à travers ses livres et influencent le mouvement Arts & Crafts, Arts et Métiers, qui se caractérise par la volonté d'évoquer la nature, par le recours aux formes gracieuses, ondulées, délicates, d'un charme doux, par les motifs décoratifs associés à des végétaux, des fleurs, des insectes, des poissons, des sirènes, des dragons et des oiseaux aux couleurs spectaculaires. Penseur économique Ruskin arriva à l'économie à partir de ses réflexions sur l'art et l'architecture. Ses premiers grands textes sur ce thème furent les deux conférences qu'il donna à Manchester en 1857, au cours de l'Art Treasures Exhibition, intitulées The Political Economy of Art, republiées augmentées en 1880 sous le titre A Joy for Ever. Dans ce haut-lieu de la pensée libérale, il déclara : Le principe du Laissez-faire est un principe de mort. Cette phrase fait écho à cet autre principe, essentiel dans son Unto This Last : Il n'y a pas d'autre richesse que la vie. Les deux se combinent : Le gouvernement et la coopération sont en tout temps et toutes choses, les lois de la vie. L'anarchie et la concurrence sont en tout temps et toutes choses, les lois de la mort. À l'origine, Unto this Last était une série de quatre articles pour le magazine de Thackeray, le Cornhill Magazine, parus en 1860 et republiés en 1862. Ruskin ne voyait donc pas l'économie de façon utilitariste en termes d'échanges marchands, mais en termes moraux. Son anticapitalisme n'est cependant pas tout à fait socialiste, même s'il influença fortement la pensée de socialistes britanniques comme William Morris. Il admirait plus l'organisation d'une société vitaliste et paternaliste médiévale. Peintre, dessinateur, aquarelliste Grâce aux cours de dessin qu'il reçut lors de son enfance, avec James Duffield Harding par exemple, John Ruskin fut un dessinateur de talent. Même s'il ne se considéra jamais comme un artiste en tant que tel ou exposa peu, il produisit quelques toiles et aquarelles. Il fut ainsi élu membre honoraire de la Royal Watercolour Society en 1873. Hommages Après sa mort, Marcel Proust donne des traductions de ses livres, en particulier la Bible d'Amiens, et rédige sa biographie. Écrits Modern Painters 1843 The Seven Lamps of Architecture 1849 ; Les Sept Lampes de l'architecture Pre-Raphaelitism 1851 The Stones of Venice 1853 ; Les Pierres de Venise Architecture and Painting 1854 Modern Painters III 1856 Political Economy of Art 1857 Modern Painters IV 1860 Unto this Last, Trois Essais de sociologie 1862 Essays on Political Economy 1862 Time and Tide 1867 Bible of Amiens 1885 ; La Bible d'Amiens, traduction en français de Marcel Proust Conférences sur l'architecture et la peinture, Introduction d'Emile Cammaerts 1909 et avant-propos d'Antoni Collot 2009 Les deux chemins – Conférences sur l’art et ses applications à la décoration et à la manufacture 1858-1859 Les Presses du Réel, traduction de Frédérique Campbell, 2011 Écrits sur les Alpes, textes réunis et commentés par Emma Sdegno et Claude Reichler, traduction d'André Hélard, Paris, Pups, 2013. Les matinées à Florence 1875/1877 Editions de l'amateur, traduction de Frédérique Campbell, 2014 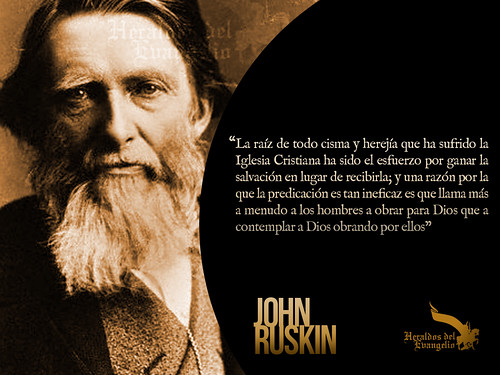  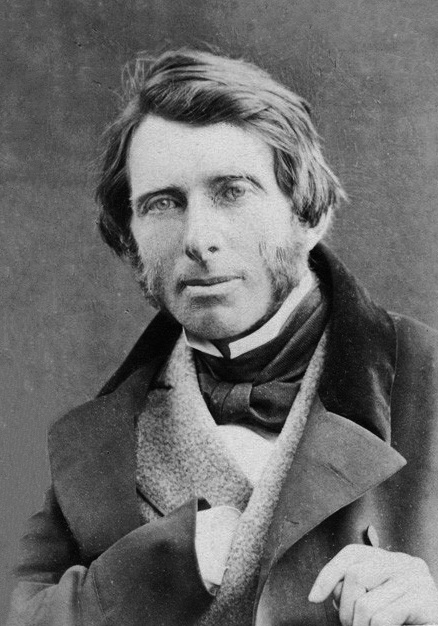       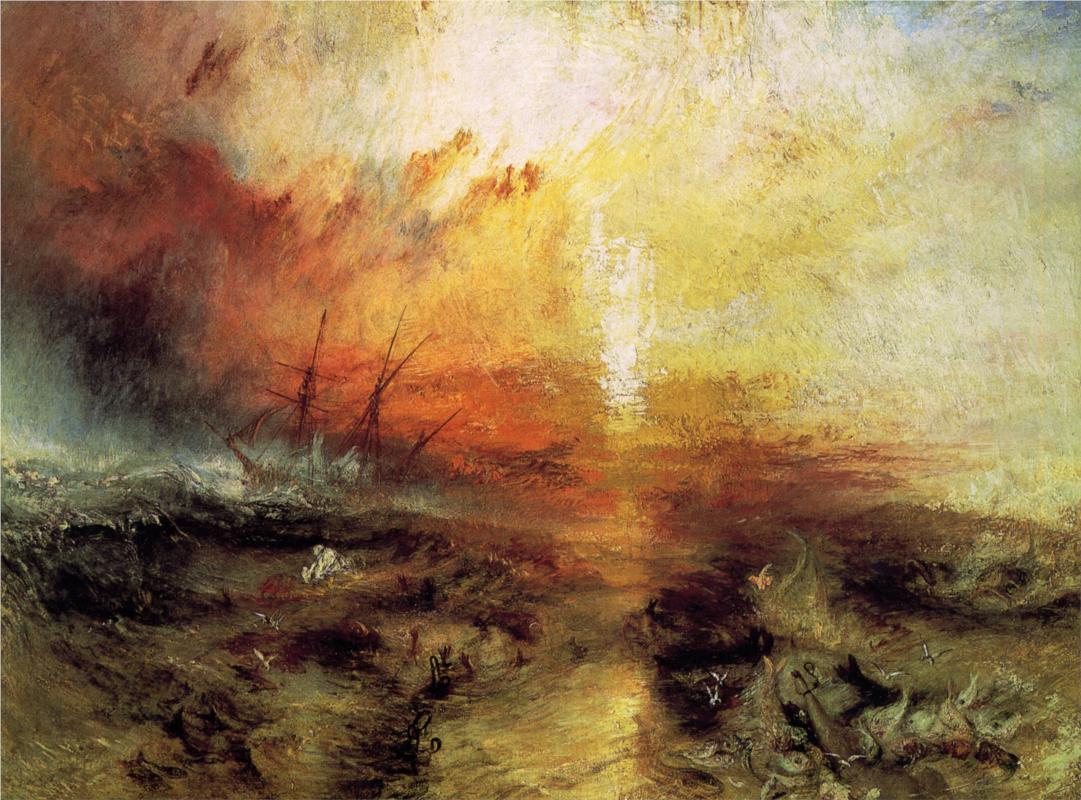      
#363
Jan Van Huysum
Loriane
Posté le : 07/02/2015 14:39
Le 8 février 1749 meurt Jan van Huysum ou Huijsum
à 66 ans, à Amsterdam, né le 5 avril 1682 à Amsterdam, peintre néerlandais. Son maître Maîtres Justus van Huysum. En Bref Fils du peintre Justus Van Huysum 1659-1716, qui avait pratiqué notamment la composition florale, il se spécialisa lui-même dans les bouquets de fleurs. Parti du style de J. D. De Heem, il s'orienta vers des compositions plus mouvementées, d'une facture précise mais froide. Il fut très imité, Jan Van Os, Gérard Van Spaendonck. Sa vie Son père, Justus van Huysum, était un peintre réputé d’histoire, de portraits, de batailles, de marines ou de fleurs, et ce qu’il y a de singulier, ajoute Descamps, c’est que ce peintre exerça tous ces genres sans être médiocre. Ainsi nourri dans la peinture, en relations journalières avec des peintres, son fils Jan ne fut pas longtemps sans manifester sa vocation. Lorsqu’il voulut être peintre, son père fut ravi de le voir suivre sa carrière et lui enseigna les premiers éléments du dessin. C’était dans la peinture des fleurs que Justus van Huysum avait le mieux réussi. Jan résolut de cultiver le même genre et, dans le cours de son existence, il ne s’en éloigna guère que pour peindre ou pour dessiner quelques paysages qui ne servirent pas à sa gloire. Jan van Huysum s’attacha principalement à étudier deux peintres de fleurs ses compatriotes, David de Heem et Abraham Mignon, qui étaient bien capables de l’instruire, mais qu’il surpassa. Dans les tableaux de ces artistes, dont quelques-uns sont au Musée du Louvre, les fleurs ont de la transparence et de la délicatesse, les fruits qu’on trouve mêlés à leurs bouquets les plus harmonieux ont de la fraîcheur, mais on n’y trouve pas l’art de l’arrangement savant et de l’enlacement gracieux que Jan Van Huysum possède au suprême degré. Personne mieux que lui n’a su rapprocher les couleurs qui s’accordent et éloigner celles qui ne s’accordent pas entre elles ; généralement il fait tomber la plus grande lumière au milieu de son tableau et il arrive doucement aux ombres et aux nuances les plus obscures par une dégradation successive des tons. Van Huysum pouvait toujours, grâce au goût des fleurs si répandu en Hollande, avoir dans son atelier les modèles les plus rares et les plus beaux. Il retira de ses œuvres un grand profit : van Huysum ayant su se concilier la bienveillance, des plus riches citoyens de la Hollande, posséder un tableau de lui était devenu la preuve d’un goût fin et d’un esprit éclairé. On rapporte que très jaloux des procédés qu’il employait, il ne supportait, dit-on, aucun témoin lorsqu’il était occupé à peindre. Une seule personne avait obtenu de le voir travailler : Margareta Haverman, qui, profitant des leçons du maître, ne tarda pas à lui inspirer la crainte qu’elle ne fit tort à sa réputation. Cet esprit un peu envieux de Van Huysum, décrit au physique comme ayant l’œil vif, la bouche fine et point du tout jalouse, le visage ovale, la physionomie spirituelle, peut-être même un peu moqueuse, quelques chagrins domestiques, la mauvaise conduite de son fils, le rendirent sombre et mélancolique et il ne voulut plus voir personne et vécut tout seul avec ses fleurs et ses fruits. Il travaillait sans cesse et toujours avec plus d’ardeur ; ses tableaux, à peine terminés, étaient déjà achetés et il n’en vendait pas plus que par impossibilité de suffire à toutes les commandes. Son frère Jacob van Huysum était également peintre. Œuvres Fruits et fleurs vers 1702, huile sur bois, 81 × 60 cm, The Wallace Collection, Londres Vase de fleurs avec un nid, huile sur toile, 79 × 60 cm, musée des beaux-arts de Lyon Redécouvertes Bouquet de fleurs, aquarelle au recto et crayon noir au verso découverte datant de 2007 de l’Alicem Institute, expertise du Professeur Alain Béjard et Dimitri Joannidès         [img width=600]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Jan_van_Huysum_(Dutch_-_Fruit_Piece_-_Google_Art_Project.jpg[/img]   
#364
Re: L'atelier de Mafalda
mafalda
Posté le : 10/02/2015 02:08
Citation :
#365
Eugene-Louis Lequesne
Loriane
Posté le : 14/02/2015 14:22
Le 15 février 1815, à Paris naît Eugène-Louis Lequesne
ou le Quesne, mort dans la même ville le 3 juin 1887 sculpteur français. Lequesne a été appelé à collaborer à la décoration de divers projets architecturaux à Paris et ailleurs. S’il n’est pas fréquent de voir un jeune avocat renoncer à une carrière juridique pour se lancer dans la statuaire avec des débuts aussi brillants, il faut aussi mentionner une autre facette assez curieuse de ses talents: Lequesne est un bon joueur d’échecs. Comme pour de nombreux sculpteurs de l’époque, plusieurs œuvres ont fait l’objet de répliques en bronze de modèle réduit, telles celles du Louvre cités ci-dessus. On en retrouve plusieurs en vente sur des sites spécialisés. La plus répandue est de loin celle du faune dansant du Luxembourg, qui représente une créature jeune et imberbe, dansant sur une outre de vin, sur laquelle s’appuie son pied gauche et soufflant dans une flûte à un seul tube, qu’il tient de sa main droite, alors que sa jambe droite et son bras gauche sont levés. Sa vie On sait, grâce à l'ouvrage de Charles Lefeuve de 1875 sur l'Histoire de Paris rue par rue et maison par maison, que Lequesne était le fils du propriétaire dans 3e arrondissement d'un immeuble d'angle, rue Villehardouin, qu'il tenait de son aïeul M. Garand, directeur général des subsistances militaires, et où aurait habité dans le passé Crébillon père. Après une formation juridique couronnée par un diplôme d’avocat, il entre en 1841 à l’école nationale des beaux-arts, dans l’atelier de James Pradier, et expose au salon dès l’année suivante. Ses études sont qualifiées de brillantes dans la notice qui lui est consacrée dans le dictionnaire Bénézit tome VIII. En 1843, il obtient en effet le deuxième prix de Rome, et en 1844 le premier prix, avec un bas-relief intitulé Pyrrhus tuant Priam, dont le plâtre est conservé à l’ENSBA. Il figure sur la liste des pensionnaires de l’académie de France à Rome de 1844 à 1849 et y côtoie cette dernière année Jean-Louis Charles Garnier, grand prix d’architecture de 1848. Durant son séjour à Rome, il sculpte une copie du faune Barberini, qui, expédiée en France en 1846, est actuellement exposée à l’ENSBA. Signalons que le faune original est exposé à la glyptothèque de Munich, et que le musée d'Orsay expose de son côté la copie de marbre réalisée par Jean-Antoine Houdon en 1778. En 1851, il obtient une médaille de 1re classe au salon, avec son faune dansant dont la version en bronze de 2 m de haut destinée au jardin du Luxembourg est exposée l’année suivante. En 1855 il se voit décerner le grand prix de sculpture à l’exposition universelle, ainsi que la Légion d'honneur. Il est devenu alors un artiste quasi-officiel du second Empire, tout comme son maître, Pradier, brusquement disparu en 1852, l’avait été pour la monarchie de Juillet. Il faut signaler les liens très étroits entre les deux sculpteurs. Des liens privilégiés avec Pradier Un site consacré à Pradier annonce un article en préparation à ce sujet. D’ores et déjà son auteur précise que « parmi tous ses anciens élèves, ce fut sans doute Eugène Lequesne que Pradier affectionnait le plus. Nommé par testament de Pradier tuteur de ses enfants, il s’est donné pour tâche de compléter plusieurs œuvres du sculpteur demeurées à l’état d’ébauche. Il retoucha aussi, à la demande de l’architecte Visconti, certains détails des douze victoires du tombeau de Napoléon et fut appelé plus tard à refaire la statue de Lille, endommagée pendant la Commune. À sa mort en 1887 il possédait plusieurs grands modèles de son maître, que son fils donna aux musées nationaux ... Le 12 mai 1854, le conseil de famille de Pradier alloue 12 000 F à Lequesne pour l’achèvement en marbre de trois statues, la Pandore, un Guerrier mourant et une Baigneuse ; Lequesne est investi du pouvoir de vendre aux personnes et aux prix qu’il jugera convenables les statues et statuettes laissées en commun. » Lorsqu’il est question d’ériger, dans la 24e division du cimetière du Père-Lachaise, le tombeau du maître, des conflits surgissent entre ses anciens élèves. « Antoine Étex, qui se flattait d’être son plus ancien élève soumit un projet, mais Eugène Louis Lequesne, en meilleurs termes avec la famille, l’évinça et réalisa le buste en bronze... Le lien privilégié entre Lequesne et Pradier est également souligné par Maxime du Camp, dans son salon de 1857 : animé par une pieuse pensée, M. Lequesne, un des plus sérieux élèves de Pradier, a exécuté en marbre un soldat mourant dont le maître avait laissé l’esquisse. Cette bonne intention trouve sa récompense dans le mérite de l’œuvre qui est belle à tous égards ... M. Lequesne s’inspirant de la maquette inachevée de Pradier, est arrivé à faire une académie originale et d’une anatomie bien observée...La main de l’élève a fait son office; elle a su ... donner à cette figure un aspect grandiose que le maître ne désavouerait pas ... Pradier ... avait composé en demi-nature un magnifique groupe représentant Ulysse portant le corps d’Achille ; nous l’avons vu souvent dans son atelier : c’est un chef-d’œuvre. Est ce que M. Lequesne, qui a gardé religieusement le souvenir de son maître, ne pourrait point exécuter ce groupe en lui donnant les proportions que Pradier avait rêvées pour lui ? On sait en outre, grâce aux fiches accessibles sur les sites du ministère de la Culture, qu’un certain nombre de dessins de Pradier ont été donnés par Lequesne au musée du Louvre, au titre de la liquidation de la succession du maître. Une autre particularité Ainsi lorsqu’en 1858-59 le champion d'échec américain Paul Morphy entreprend une tournée européenne, il est opposé simultanément à 8 champions français dans une partie “à l’aveugle” qui dure dix heures au café de la Régence à Paris. Au nombre de ces huit français figure Eugène -Louis Lequesne, qui devient son ami et lui rend hommage en lui sculptant en marbre son buste, qui est ensuite placé, couronné de lauriers, à côté de ceux d’autres champions fameux, Labourdonnais et Philidor, au club d’échecs à l’étage du café de la régence. Ce buste est exposé au salon de 1859, et Lequesne offre au champion un second exemplaire de marbre de plus petit format ; en outre des répliques de bronze aux 3/5 en sont tirées et commercialisées. Charles Lefeuve, cité plus haut, indique à propos de l'immeuble Lequesne: " M. Lequesne, sculpteur distingué et joueur d'échecs dont les parties se notent, est le fils du propriétaire. D'après un article intitulé Les cafés artistiques et littéraires de Paris, paru en 18823.Les joueurs dont on suit les parties avec le plus d'attention sont : M. de Rosenthal, un Polonais ; M. Festhamel qui, au Monde Illustré, à feu l'Opinion Nationale, au Siècle, pose les problèmes les plus difficiles ; M. le vicomte de Bornier ; d'après les on-dit des connaisseurs, l'auteur de la Fille de Roland est, en peu de temps, devenu d'une force remarquable ; M. Chaseray, commissaire-priseur, qui se délasse des fatigues de l'Hôtel des Ventes devant un échiquier ; le sculpteur Lequesne ; M. Baucher, fils du professeur d'équitation ; M. Charles Jolliet, dont la voix emplit la salle ; M. Auguste Jolliet, des Français, M. Prudhon du même théâtre ; M. Séguin ; M. Charles Royer, un lettré qui a écrit, pour plusieurs volumes de Lemerre, des préfaces très remarquables. M. Royer est le neveu de M. Garnier-Pagès, dont on apercevait quelquefois à la Régence les longs cheveux blancs retombant sur son immense faux-col ; M. Maubant, de la Comédie-Française ; M. de la Noue, gendre de l'ancien ministre de l'Empire, M. Billaut ; un officier en retraite, M. Coulon, qui pousse ses pièces avec un sang-froid tout militaire". Œuvres majeures La bonne mère La Renommée retenant Pégase Parmi les œuvres de Lequesne les plus connues du grand public, il faut placer au premier rang la statue géante de la vierge et de l’enfant Jésus — la Bonne Mère — qui surplombe à Marseille le campanile de la basilique Notre-Dame-de-la-Garde, dont la première pierre fut posée en septembre 1853 et dont la consécration eut lieu le 5 juin 1864 mais le chantier se poursuivit jusqu’en 1870. Le projet de Lequesne l’emporta sur ceux de ses confrères Millet et Gumery. Selon la plupart des sources disponibles, la statue monumentale de cuivre, haute de plus de 9 m, fut dorée à la feuille par les ateliers Christofle de Paris. Elle pèse 4 500 kg et est datée de 1867. Le visage de la vierge à lui seul mesurerait 1,25 m et celui de l’enfant Jésus 0,80 m, dont le tour de poignet serait de 1,10 m. Un escalier à vis est aménagé dans la statue d’où on découvre la Méditerranée par l’ouverture des yeux. La statue fut installée en 1870. Sous le second empire l’érection de statues religieuses de ce format n’est pas exceptionnelle et on peut en trouver divers exemples dans La sculpture française au xixe siècle, ouvrage de référence édité par les affaires culturelles à l’occasion de l’exposition de 1986 au Grand Palais, dont un chapitre est consacré aux vierges colossales du Second Empire, qu’on retrouve par exemple à Clermont-Ferrand, à Biarritz, à Châteaurenard, à Lourdes, à Bordeaux, au Puy, etc. Les chiffres donnés par le site officiel sont divergents : Hauteur de la statue de la Vierge : 11,20 m. Hauteur totale de la statue et de son piédestal : 23,70 m. Masse de la statue : 9 796 kg 16 t en incluant la structure intérieure. Diamètre de la partie la plus large : 3,60 m. Altitude du sommet de la statue : 225,70 m. Les deux Pégase de l’Opéra de Paris En second viennent les deux groupes monumentaux de bronze de la renommée retenant Pégase qui ornent, en arrière de terrasse de la façade sud, la toiture en pignon de la scène de l’Opéra de Paris, de part et d’autre du groupe central d’Aimé Millet. Le musée d’Orsay possède les maquettes en plâtre de Lequesne. On sait que l’architecte Charles Garnier, que Lequesne avait côtoyé en 1849 à l’académie française de Rome, fit appel, pour la décoration de son chef-d’œuvre, aux meilleurs sculpteurs de l’époque, et notamment aux lauréats du prix de Rome. Selon une notice des Monuments de France, les groupes en galvanoplastie, haut de 5 mètres, exécutés en 1867-68, ont été restaurés en 1985 par l’ifroa. Le Faune dansant du jardin du Luxembourg Le Faune au Jardin du Luxembourg La version en bronze fondue par Fonderie Eck et Durand, et exposée au salon de 1852, mesure 2 m de haut. Comme on l’a vu, Lequesne, durant son séjour à Rome, avait eu l’occasion de copier diverses œuvres antiques, dont le faune Barberini. Le faune dansant du Luxembourg s’inspire à l’origine du faune dansant de Pompéi, conservé au musée de Naples, mais n’en est pas moins dépourvu d’originalité, ce qui explique le bon accueil au salon de 1851 de sa version destinée à la fonte5 et la médaille de 1re classe obtenue par son créateur. Les statues de La Foi, La Charité et L'Espérance Dominant la balustrade située entre les 3 fontaines en contrebas et le porche principal de l’Église de la Sainte-Trinité, édifiée à Paris entre 1861 et 1867. En l’occurrence il s’agit d’œuvres commencées par Francisque Duret, et terminées par Lequesne après le décès du premier. Autres ouvrages À Paris, il a apporté sa part à la statuaire des façades de nombreux édifices publics : il a sculpté les cariatides et statues des pavillons Moellien et Denon au Louvre toujours au Louvre, on lui doit, dans la cour Napoléon, la statue de Philippe de Commynes sur la façade nord du palais de justice correspondant aux locaux de la cour de Cassation, il est l’auteur des statues cariatides de la force, de la justice, de l’innocence et du crime ; à la gare du Nord, il est l’auteur des statues représentant les villes d’Amiens et de Rouen ; au cirque d’hiver : si l’on crédite Pradier de la grande frise circulaire sous les croisées, il apparait qu’y ont collaboré en fait plusieurs de ses élèves, Duret, Bosio, Guillaume, Lequesne, Husson et Dantan, qui y travaillèrent en s’inspirant des moules utilisés pour le cirque des Champs-Élysées ; hors projets architecturaux, le dictionnaire de Bénézit cite de lui un saint Louis pour l’église parisienne Saint Paul-saint Louis, et un saint Cloud, pour celle, également parisienne de Sainte Clotilde. Toujours à Paris, à la Comédie Française, on lui doit la frise ornant la monumentale cheminée de marbre sur laquelle repose, dans le foyer Pierre Dux, le fameux buste de Molière par Houdon. Lequesne a représenté 16 personnages des œuvres de Molière assistant au couronnement de son buste, au nombre desquels sont bien reconnaissables M. Jourdain, Scapin, Alceste, Mercure, Diafoirus, etc. à Marseille il participe aux sculptures de la façade de la préfecture, inaugurée le 1er janvier 1867, conjointement avec plusieurs prix de Rome, comme Gumery et Guillaume. à Amiens, il décore l’extérieur du Musée de Picardie, création du second empire Musée Napoléon. Il est l’auteur des cariatides et des médaillons visibles sur la façade. À l’intérieur il a sculpté un griffon antique monumental destiné à la décoration du grand escalier, que mentionne Louis Auvray dans son salon de 1863 accessible sur Gallica. à Quimper, il est l’auteur du monument de Laënnec élevé par souscription des médecins bretons, français et étrangers au célèbre médecin, inventeur de l’auscultation, né dans cette ville le 17 février 1781 et décédé non loin de là à Ploaré en 1826. La statue8, datée de 1867, et portant la marque des fondeurs Boyer et Rolland, a été inaugurée en mai 1868 sur l’esplanade entre la mairie et la cathédrale. Signalons au passage une certaine impression de déjà vu, lorsqu’on la compare à la statue de Jean- Jacques Rousseau de Pradier, exposée à Genève. Il y a certes des différences de détails le style du siège, la main pointée vers le haut, qui est tantôt celle de droite tantôt celle de gauche, etc.... Mais ne faut-il pas y voir simplement l’hommage posthume de l’ancien élève au maître disparu ? à La Flèche, il a sculpté en pierre l'allégorie de la ville, sur le mausolée dédié à l'ancien maire François-Théodore Latouche, élevé en 1862 par souscription publique au cimetière Saint Thomas. à Chaulnes, il est l'auteur de la statue en pierre du grammairien et latiniste Lhomond, originaire de cette commune de la Somme, dont le monument a été élevé en 1860 par souscription publique. à Angoulême, il est l'auteur du buste en marbre d'Eusèbe Castaigne, bibliothécaire et érudit charentais, élevé par souscription de la société charentaise archéologique et historique, et inauguré le 15 juin 1870. à Cognac on cite le buste élevé à la mémoire de M. Emile Albert, avocat, par ailleurs bibliothécaire et érudit charentais lui aussi. Le dictionnaire Bénézit cite comme œuvres de Lequesne dans divers musées : au musée d’Amiens: Thuillier Constant, du Cange, L’Industrie, La Sculpture. Ces indications entraînent plus de questions que de réponses. Ces œuvres correspondent-elles aux médaillons et cariatides de la façade ou sont elles exposées à l’intérieur? Lequesne est-il en outre l’auteur de la statue de bronze de Du Cange, érigée en 1849 à Amiens sous l’égide de la société des antiquaires de Picardie ? au musée de Beaufort : un masque d’Homère. au musée de Bordeaux : un faune dansant. au musée de Cambrai : une prêtresse de Bacchus. au musée de Chartres : À quoi rêvent les jeunes filles et Vercingétorix vaincu défiant les soldats romains. au musée de Palais des beaux-arts de Lille : Camulogène, statue en plâtre, 178 x 97 x 115 cm, 1872. à la faculté de médecine de Paris, le buste de Laënnec. au musée de Roanne : Thuillier. au musée de Versailles : le maréchal de Saint Amand ou Saint Arnaud ?. il serait aussi l’auteur d’une statue de Napoléon III, sans précision de lieu. En outre, selon les fiches du ministère de la Culture, le musée du Louvre détient des bronzes de dimension réduite de Lequesne, les deux Parque datés de 1860 environ, ainsi que Sapho et Phaon, fondu par Gonon et daté de 1850. Œuvres à exemplaires multiples " Faune dansant du Luxembourg " Il existe un second faune dansant, représentant un sujet nettement plus âgé et barbu levant également la jambe droite, mais soufflant dans une flute double qu’il tient à deux mains. L’outre de bronze fait défaut .Il correspond sans doute à l’esquisse exposée au salon de 1887, qui fut le dernier de Lequesne. Sont mentionnées comme ayant été exposées au 5e salon de antiquaires à Paris en février 1999 deux statues, les mathématiques d’une part, et la fortune et le succès de l’autre. Il s’agit de modèles mesurant 1,60 m de haut et 50 cm de large, provenant de la fonderie Durenne à Paris. Dans un format monumental, des modèle grandeur nature d’un cheval anglo-arabe, fondu en bronze ou en fer et datés de 1861, fonte de bronze de JJ Ducel et 1867 fonte en fer, sont présentés sur des sites commerciaux. Les dimensions précisées pour le premier sont 2,50 m, en longueur, 1,48 m au garrot 1,90 m en hauteur totale. pour le 2e elles sont de 200 × 198 × 83 cm, sans autre précision. À cet égard on relève l’intérêt de Lequesne pour les chevaux, Pégase, frise du cirque d’hiver, statue du cheval anglo-arabe…. Il a d’ailleurs exposé au salon de 1866 le buste du général Daumas, qui après avoir servi en Algérie comme consul de France à Mascara entre 1837 et 1839, commanda l’école de cavalerie de Saumur, et est l’auteur d’un savant ouvrage, faisant toujours autorité, sur les chevaux du Sahara, qui présente l’étrange particularité d’avoir été soumis avant impression aux commentaires techniques de l’émir Abd el-Kader en personne…, qui figurent, imprimé en regard de chaque page de l’édition de 1853. Quand l’on sait qu’Abd-El-Kader et ses proches ont été internés aux châteaux de Pau puis d’Amboise, de 1848 à 1852, il ne serait pas impossible que Lequesne ait croisé leur chemin. Diverses communes de France possèdent soit en buste, soit en pied, des statues de la République qui ont été tirées en de nombreux exemplaires, et érigées dans les années 1900-1910, soit longtemps après le décès de Lequesne. On peut citer ainsi dans l’Aude, pour le buste, la commune d'Esperaza, et pour la statue, celles d’Alet-les-Bains, Bages, Marcorignan, Ouveillan, etc. Lequesne, comme le souligne la notice du Bénézit, utilise aussi bien les matériaux classiques tels le marbre et le bronze que les techniques nouvelles de la fonte de fer fonte d'art. C’est en effet dans cette matière que sont éditées les statues sur pied de la République fondues par Ducel et fils, et dont la fiche de l’inventaire général des affaires culturelles, précise, pour celle de Marcorignan, qu’elle fut acquise par la commune en 1882 auprès de M. Plancard, “marchand de fonderies de fer et de cuivre” à Carcassonne. À propos de la statue de l’été, en fonte de fer, exposée au salon de 1864, le sculpteur et critique Louis Auvray9 livre le commentaire suivant : les critiques ont, selon nous, trop généralement le tort de juger toutes les sculptures au même point de vue, et de ne pas faire la part de la sculpture architectonique pour les ouvrages destinés à la décoration d’édifices avec le style desquels ils doivent s’harmoniser. C’est à ce genre de sculpture qu’appartient la statue de l’été, à laquelle M. Lequesne a su donner un style simple et monumental. Ainsi grâce à ces procédés techniques nouveaux, les modèles de Lequesne acquis par Ducel, puis repris par le Val d'Osne après 1878, sont légion, et leur diffusion atteint jusqu’à l’Amérique latine : Le printemps, l’été, l’automne, l’hiver, la justice, la concorde, la liberté, la fidélité sont à Recife, l’amour à la lyre à Rio. Et encore : saint Jean, saint Vincent de Paul avec enfant, saint tenant la croix, enfants torchères, sphinx, cheval Santiago. Relevé chronologique des œuvres présentées au Salon des Beaux-Arts Les ouvrages cités en référence peuvent être consulté sur la base Gallica de la bibliothèque nationale de France. Il y a des lacunes pour les années 1853, 1854,1855, 1856, 1858, 1859, 1860, 1861 et 1862 et des doutes pour 1851 Faune dansant, modèle de plâtre destiné à être coulé en bronze. bustes de plâtre de Portalis et de l’actrice Siona Lévy. 1852 : Faune dansant, version en bronze pour le jardin du Luxembourg. 1857 : réf Maxime du Camp. Soldat mourant en marbre, d’après l’esquisse de Pradier. Selon une autre référence, le site d'Alain Atlan, antiquaire à Paris, au salon de 1857 il envoie une petite statue, Baigneuse et une statuette, Lesbie, toutes deux en bronze, une statue du docteur Laënnec pour la ville de Quimper, une statue de saint Cloud et une statue de saint Louis. C’est sujet à caution, car il y a une erreur de 10 ans pour la statue de Laënnec. 1863 : ref Louis Auvray. Griffon antique destiné au grand escalier du musée Napoléon à Amiens. 1864 : réf catalogue officiel + Louis Auvray L’été, statue fonte de fer. Portrait de M. Reinaud, orientaliste, membre de l’Institut, Académie des inscriptions et belles lettres, buste marbre. 1865 : réf catalogue + Louis Auvray. Portrait de M. T., président de section au Conseil d’État, buste marbre. 1866 : réf catalogue + Louis Auvray + Émile Zola. Portrait de M. le général Daumas, buste plâtre. 1867 : réf catalogue. Statue en bronze du Dr Laënnec (pour la ville de Quimper). 1868 : ref catalogue. Prêtresse de Bacchus, statue plâtre. Portrait de son excellence le vicomte de Païva, ministre plénipotentiaire du Portugal, buste plâtre. 1869 : réf catalogue + Louis Auvray. Portrait de Mlle S., buste plâtre. 1870 : réf Catalogue. Prêtresse de Bacchus, statue marbre. Camulogène, statue plâtre. 1872 : réf catalogue. Baigneuse, statue plâtre 1874 : réf catalogue. À quoi rêvent les jeunes filles, statue plâtre. Portrait de M. de Maupas, ancien ministre, buste marbre c’est lui qui a supervisé, pour le compte du gouvernement impérial, l’élaboration du projet et les travaux de construction de la basilique Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille. 1876 : réf catalogue. Gaulois au poteau, statue plâtre. 1877 : réf catalogue; Portrait de Mme ***, buste plâtre. 1879 : réf catalogue. Laënnec, buste plâtre. 1880 réf catalogue. Portrait de M.le docteur Jules Guérin, buste plâtre. 1883 : réf catalogue. Portrait de M. Lassalle, buste plâtre. Laënnec, buste bronze, offert à la faculté de médecine par M. le professeur Potain. 1884 : réf catalogue. Portrait de Mlle Rosita Mauri, buste plâtre. Portrait de M. Mérante, buste plâtre. (Mlle Mauri est une célèbre danseuse de l’époque, dont il subsiste divers portraits peints ou sculptés, et M. Mérante est à l'époque son chorégraphe attitré). 1885 : La France au Tonkin, buste plâtre. Jeune romaine, tête d’étude, bronze. 1886 : réf catalogue + catalogue illustré. Portrait de M. Léon Lechapelier, buste plâtre il y a son dessin au catalogue illustré 1887 : réf catalogue; Faune dansant, esquisse, bronze Voir aussi Le Figaro du 7 juin 1887, accessible sur Gallica, informe ses lecteurs du décès de Lequesne dans les termes suivants: "On a célébré hier à saint Louis d'Antin, les obsèques de M. Le Quesne, le statuaire bien connu, membre de l'Institut.L'une de ses plus jolies œuvres, le faune dansant, se trouve dans le jardin du Luxembourg. Sa baigneuse et sa Lesbie, notamment, ont été l'objet de reproductions sans nombre."           
#367
Jean-Baptiste Corot
Loriane
Posté le : 21/02/2015 16:22
Le 22 février 1875, à 78 ans, meurt Jean-Baptiste Camille Corot
dans le 10e arrondissement de Paris, au 56 de la rue du Faubourg-Poissonnière, né le 16 juillet 1796 à Paris, peintre et graveur français formé à l'académie de Charles Suisse, il eut pour élève Charles le Roux. Il passa longtemps pour un peintre amateur qui avait tout loisir de voyager non seulement un peu partout en France, mais aussi en Italie, où il résida à trois reprises. Au cours de ses pérégrinations, il ne cessa de peindre des paysages idylliques, généralement étoffés de petits personnages, selon les règles du paysage classique. Il est l'un des fondateurs de l'école de Barbizon. En bref Zola voyait en Corot un précurseur de Pissarro et de Jongkind, le premier à avoir rompu avec le paysage classique hérité de Poussin, pionnier de la peinture de plein air et du “sentiment vrai ... de la nature” Mon Salon. Les paysagistes, 1868. Ce jugement, fondé essentiellement sur les paysages de la dernière manière de l'artiste, ne rend pas compte de l'originalité véritable de Corot. Un “pleinairisme” avant la lettre se pratiquait depuis longtemps – chez Alexandre François Desportes 1661-1743, chez le Gallois Thomas Jones 1743-1803. À l'inverse, une toile comme Souvenir de Mortefontaine 1864, musée du Louvre renoue, tard dans le siècle, avec le classique paysage composé en atelier, peuplé de figures de convention, dont le jeune Corot passe pour avoir été le fossoyeur. Jusqu'à la fin de sa vie, Corot resta un classique. La révolution dont on le crédite dans l'art du paysage s'inscrit en fait dans la logique amorcée par Pierre-Henri de Valenciennes, 1750-1819 et par les tenants du “paysage historique” de la fin du XVIIIe siècle. Les études italiennes peintes par ce fils de commerçants parisiens, parti pour Rome à ses frais, entre 1825 et 1828, affichent un refus quelque peu ambigu de l'“histoire”, s'attachent à une nature très construite, géométrisée, souvent urbaine. Elles renouvellent le genre de la veduta, vue stéréotypée peinte pour une clientèle de touristes. Attentif à toutes les innovations – pratiquant parmi les premiers 1853 la technique du cliché-verre qui consiste à dessiner sur une plaque photographique, tirée ensuite sur papier sensible –, Corot resta un esprit libre, jouant les autodidactes naïfs, en marge des courants artistiques de son temp. Les Salons très politisés de l'époque révolutionnaire ont paradoxalement consacré en France le succès du paysage et du portrait. La production dans ces domaines – à Paris, en province, dans le groupe européen des artistes vivant à Rome – accompagne un relatif désintérêt du public pour la peinture d'histoire officielle. Élève d'Achille-Etna Michallon 1796-1822, premier lauréat du prix de Rome de paysage historique, institué à l'instigation de Valenciennes, et qui marqua officiellement la reconnaissance académique d'un genre tenu pour mineur depuis le XVIIe siècle, passé après la mort de Michallon dans l'atelier de Jean-Victor Bertin, 1767-1842, Jean-Baptiste Camille Corot apprit à travailler sur le motif pour composer ensuite, en atelier, des paysages qui servent de décor à une action historique, biblique ou mythologique. La technique de l'époque est simple : l'artiste dessine en plein air, peint sur le motif des “études” à l'huile sur carton. Ces matériaux sont nécessaires à l'élaboration des compositions exposées ensuite, qui n'ont qu'un rapport lointain avec le réel. Toute sa vie, Corot s'adonna à ce genre noble, qui rattache le paysage à la “grande peinture”. Un tableau comme Agar dans le désert, 1835, Metropolitan Museum, New York est construit en reprenant des éléments arbres, rochers étudiés en divers lieux. Tant Homère et les Bergers, 1845, musée de Saint-Lô que le Baptême du Christ, 1845-1847, église Saint-Nicolas-du-Chardonnet, Paris témoignent de cette volonté de prolonger, dans la composition autant que dans les sujets eux-mêmes, une tradition. Dans ses œuvres tardives, alors que le paysage historique est un genre démodé, que le prix de Rome en cette section avait été supprimé 1863, Corot continue de peindre des divinités dans les forêts imaginaires qu'il prétend représenter “de souvenir” Une matinée, danse des nymphes, 1860, musée d'Orsay. On peut donc interpréter ses dernières œuvres comme l'affirmation, à contre-courant, de la pérennité d'une manière qu'il hérite entièrement du XVIIIe siècle. Corot s'affiche lecteur d'André Chénier en un temps où le réalisme triomphe. Zola s'écrie en 1866 : “Si M. Corot consentait à tuer une fois pour toutes les nymphes dont il peuple ses bois, et à les remplacer par des paysannes, je l'aimerais outre mesure.” Sa vie Jean-Baptiste Camille Corot est né au numéro 125 de la rue du Bac, à Paris. Corot est issu d’une famille de commerçants aisés : sa mère, Marie-Françoise Corot 1768-1851, née Oberson, était d’origine suisse, et son père, Jacques Louis Corot 1771-1847, d'origine bourguignonne, tiennent un magasin de mode réputé, à l’angle de la rue du Bac et du quai Voltaire, à Paris5. Les Corot ont deux autres enfants, Annette Octavie 1793-1874 et Victoire Anne 1797-1821 qui vivent à l'étage au-dessus du magasin. Corot fait des études sans éclat à la pension Letellier à Paris 1803-1807, puis au Lycée Pierre-Corneille de Rouen 1807-1812. Le dimanche, il est accueilli par des amis de ses parents, les Sennegon, auprès desquels il apprendra à aimer la nature, famille dont le fils, Laurent Denis Sennegon épousera la sœur du peintre en 1817. Au sortir du pensionnat du lycée de Poissy en 1815, il est placé par son père chez deux marchands de drap successivement, à Paris, Ratier, rue de Richelieu où le nouvel apprenti se révèle un si piètre vendeur que son patron l'emploie comme commis coursier, et en 1817 Delalain, rue Saint-Honoré. Mais le jeune homme n’a guère de goût pour le commerce, et suit des cours de dessin à l'Académie de Charles Suisse du quai des Orfèvres le soir. En 1822, alors que son père veut l'établir en lui offrant un fonds de commerce pour reprendre le flambeau familial, il finit par convaincre ses parents de l’autoriser à poursuivre une carrière de peintre, en obtenant d’eux une rente annuelle de 1 500 livres, dont bénéficiait précédemment sa sœur morte en 1821. L’aisance de ses parents le met à l’abri du besoin, mais, en contrepartie, il restera dépendant d’eux jusqu’à leur mort. Il peut désormais louer un studio quai Voltaire et en fait son atelier Au printemps de cette même année, il entre dans l’atelier du peintre paysagiste Achille Etna Michallon, guère plus âgé que lui, qui rentre de Rome, où l’a conduit le Grand Prix du paysage historique, obtenu en 1817. Michallon inculque à Corot les principes du néoclassicisme et l’encourage à travailler en plein air. Mais il meurt quelques mois plus tard, et Corot poursuit sa formation avec Jean-Victor Bertin, qui a eu Michallon comme élève, et qui, comme lui, enseigne à Corot la science des compositions néoclassiques et du paysage historique. Ses deux maîtres ont été des élèves et émules de Pierre-Henri de Valenciennes, un des précurseurs du paysage moderne qui encourageait ses élèves à peindre en plein air des études qui leur servaient ensuite pour composer leurs tableaux. C'est dans cette lignée que Bertin l’incite à aller travailler en forêt de Fontainebleau. Corot sera ainsi l’un des premiers peintres à travailler dans le village de Barbizon. Il ira également peindre dans la vallée de la Seine, et sur les côtes de la Manche. Le rapport entre les idéaux classiques et l’observation de la nature, lui-même hérité de l’enseignement de Pierre-Henri de Valenciennes, devait rester fondamental tout au long de sa carrière. Le début d’une carrière Depuis le xviiie siècle, le voyage en Italie fait partie du Grand Tour, formation de tout jeune artiste. Corot est déjà familier des paysages italiens, qu’il a copiés sur les toiles rapportées d’Italie par son maître Michallon. C’est donc tout naturellement qu’il demande à ses parents de financer son premier voyage. Il séjournera, entre 1825 et 1828, à Rome, Naples et Venise. Durant ce séjour, il se lie à un autre paysagiste néoclassique précurseur de l’école de Barbizon, Théodore Caruelle d'Aligny. Il se rend une seconde fois en Italie en 1834 Toscane, Venise, et à nouveau en 1843. Corot parcourt aussi sans relâche les provinces françaises à la recherche de paysages qu’il peint pour le plaisir et pour l’enrichissement visuel qu’ils lui apportent : s’il a commencé à exercer ses talents de jeune peintre à Ville-d'Avray, près de Paris, il se rend fréquemment, entre 1830 et 1845, en Normandie, chez ses amis les Sennegon, mais aussi en Auvergne, en Provence, en Bourgogne, en Bretagne, chez son élève et ami Charles Le Roux, au Pasquiaud en Corsept, en Charente, dans le Morvan en particulier à Lormes, ainsi qu’en Suisse. Le plus souvent, il séjourne chez des amis peintres ou drapiers. Il peint surtout des paysages, mais s’intéresse aussi avec bonheur aux architectures, La Cathédrale de Chartres, 1830. Mais ces toiles ne sont pour lui que des études, qu’il ne songe pas à exposer. Elles sont en effet destinées à être réemployées dans des compositions plus ambitieuses, à caractère historique, mythologique ou religieux, seules dignes, selon l’idéal néoclassique, d’être présentées au public. Corot affronte pour la première fois le Salon en 1835 avec un grand tableau intitulé Agar dans le désert, illustration d’un épisode de la Genèse, qui est reçu favorablement. Dans les années suivantes, Corot participera régulièrement au Salon, alternant thèmes religieux et mythologiques. À partir de cette époque, il attire l’attention de ses contemporains et, souvent, leur admiration. Pourtant, Corot s’avère difficile à classer, et échappe aux écoles : si les modernes, séduits par son traitement du paysage, regrettent son attachement obstiné aux thèmes néoclassiques, les néoclassiques, pour leur part, regimbent devant le traitement réaliste de ses arbres et de ses rochers. La maturité À partir des années 1850, la notoriété de Corot grandit, et le public et les marchands commencent à s’intéresser à lui. Ses parents disparus (sa mère en 1851, son père dès 1847, il se trouve à la fois plus indépendant financièrement et libéré des contraintes familiales. Il continue à voyager, parcourt le Dauphiné en compagnie du peintre et ami Daubigny, avec qui il va peindre à Auvers-sur-Oise. Corot se rend régulièrement à Arras et Douai, chez Constant Dutilleux et ses deux gendres Charles Desavary et Alfred Robaut, avec qui il s’est lié d’amitié. Il s’initie auprès de Dutilleux à la technique du cliché-verre, dont il produira une soixantaine d’exemplaires. Il se rend à plusieurs reprises en Limousin, notamment à Saint-Junien, sur les bords de la Glane, site qui porte désormais son nom et au Mas Bilier, près de Limoges, chez un de ses amis. Il est, par ailleurs, de plus en plus attiré, à partir de 1850, par une peinture dans laquelle il laisse libre cours à son imagination, délaissant l’exactitude du paysage peint sur le motif, qu’il remodèle à son gré, et renonçant aux récits historiques, qui ne sont plus qu’un prétexte à des paysages rêvés et baignés de halos argentés ou dorés. Le thème du souvenir devient prépondérant dans son œuvre, mêlant les réminiscences d’un site et les émotions qui restent associées dans la mémoire du peintre. Se succèdent alors des toiles telles que Matinée, Danse des Nymphes, Souvenir de Marcoussis ou le célèbre Souvenir de Mortefontaine. En 1862-1863, il séjourne à Saintes et participe, avec Gustave Courbet, Louis-Augustin Auguin et Hippolyte Pradelles à un atelier de plein air baptisé groupe du Port-Berteau d'après le nom du joli site des bords de la Charente dans la commune de Bussac-sur-Charente adopté pour leurs séances communes de peinture. Point d'orgue de la convergence féconde entre les quatre artistes, une exposition collective réunissant 170 œuvres est présentée au public le 15 janvier 1863 à l’hôtel de ville de Saintes. En 1846, il est fait chevalier de la Légion d'honneur pour son œuvre, et il est promu officier en 1867. Cependant, ses amis, considérant qu’il n’avait pas été officiellement reconnu à sa juste valeur (il n’avait pas reçu la médaille de première classe au Salon, lui offrirent leur propre médaille en 1874, peu avant sa mort. Pendant les dernières années de sa vie, Corot gagna de fortes sommes d’argent grâce à ses toiles, qui étaient très demandées. Sa générosité était proverbiale : en 1871, il donna 20 000 francs aux pauvres de Paris, qui subissaient le siège des Prussiens. En 1872, il acheta une maison à Auvers-sur-Oise, qu’il offrit à Honoré Daumier, devenu aveugle et sans ressource. En 1875, il donna 10 000 francs à la veuve de Jean-François Millet pour l’aider à élever ses enfants. Sa générosité n’était donc pas une légende. Il aida également financièrement un centre pour jeunes déshérités, rue Vandrezanne, à Paris. Retiré à Coubron en automne 1874, où se situent les vestiges de la célèbre forêt de Bondy, et, atteint d'un cancer à l'estomac, Corot en revint le 25 janvier 1875. Il resta alité, pour mourir à Paris le 22 février 1875 à 11 h3,2. Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise division 24. On voir sur la tombe de Jean batiste corot, une fontaine de marbre blanc ornée d’un médaillon de bronze sculpté par Adolphe-Victor Geoffroy-Dechaume, inaugurée le 27 mai 1880, borde la rive est de l’étang neuf de Ville-d’Avray. Les “études” Quand Corot s'emploie en revanche à peindre dans des sites obligés, il en renouvelle la vision, Le Colisée vu de la basilique de Constantin, musée du Louvre. Faites pour rester à l'atelier, pour servir d'aide-mémoire, ces études fixent un instant de la journée, un éclairage. Utiles à l'artiste et à ses élèves, ces tableautins que l'on n'encadrait pas décoraient au retour les murs des ateliers, voir l'arrière-plan de La Dame en bleu, 1874, musée du Louvre. On les conservait rarement après la mort des artistes. Il est donc original, en ces années, de s'affirmer comme un maître de l'étude peinte. Corot acquiert une renommée certaine dans le milieu cosmopolite des paysagistes qui travaillent alors dans la campagne romaine, mais, comme les Britanniques, les Allemands, les Nordiques avec lesquels, dans le petit groupe français, il travaille, il se place lui aussi dans les sites pittoresques. On reconnaît son habileté, nul ne le juge “révolutionnaire”. C'est l'idée de montrer à tous de telles pochades, comme Corot lui-même les nommait, de les considérer comme des œuvres achevées, susceptibles d'être exposées, qui constitue sans doute la révolution opérée par l'artiste. À une époque où son ambition reste d'envoyer au Salon un grand paysage composé, conçu strictement selon les normes du temps, Le Pont de Narni, 1827, National Gallery, Ottawa, il n'a sans doute aucune conscience de la valeur que le goût des années suivantes accorderait à une production mineure, très abondante, mais clairement en marge de son métier. Si révolution il y a, elle intervient tardivement : ce n'est qu'en 1849 qu'il expose au Salon la Vue du Colisée, peinte en 1826, et qu'à sa mort il légua au Louvre. Le tableau fait partie d'un “triptyque”, avec Le Forum, musée du Louvre, et Vue des jardins Farnèse, Phillips Collection, Washington, qui constitue à la fois un hommage à la classique peinture de ruines, de tradition romaine, et un regroupement d'études montrant un même lieu, sous des angles différents, à trois moments de la journée. Commencées en plein air, élaborées en plusieurs séances, de telles toiles sont retravaillées en atelier, notamment dans les frondaisons, pour en accentuer de manière artificielle le caractère spontané. Le regard du peintre sur la Rome antique, considérée comme un paysage comme un autre, était neuf en 1826 ; le regard du spectateur de 1849, qui a appris à voir des paysages sans figures mythologiques, qui ne racontent rien et prétendent à la vérité, l'est tout autant. Tout au long de ses voyages en France, outre le séjour italien de sa jeunesse et les deux voyages qu'il fit à nouveau dans la péninsule en 1834 et en 1843, Corot multiplie les “vues”, naïves en apparence, de ce qu'il voit de sa fenêtre ou du bord d'un chemin, Orléans et la tour de Saint-Paterne, 1843, musée de Strasbourg. Pourtant, la culture visuelle de celui qui s'habille comme un paysan pour arpenter la campagne et prétend tout ignorer des maîtres est réelle. À Rome, il avait peint, comme un hommage, une vue des berges du Tibre, sans personnage, La Promenade du Poussin 1826-1827, musée du Louvre. Son Odalisque romaine Marietta, 1843, Petit Palais invoque Ingres. La Jeune Fille à la perle, 1869, musée du Louvre emprunte sa pose à la Joconde. Corot a donc conscience d'inscrire sa peinture dans une histoire de l'art. Ses révolutions ont toujours été faites dans la voie que ses maîtres lui avaient désignée : faire reconnaître la dignité du paysage ; montrer, grâce à ses figures et à ses portraits Claire Sennegon, 1838, musée du Louvre, qu'il n'est pas qu'un paysagiste. Corot, chef d'école ? Corot se distingue donc autant du néo-classicisme qui constituait sa culture de jeunesse que d'un romantisme, devenu style officiel à l'époque de sa maturité. Admiré par Delacroix et par Baudelaire, par Millet et par Zola, il s'affiche indifférent aux débats artistiques de son temps. Sans préoccupations politiques, il commence en 1830 à peindre la cathédrale de Chartres, achevée en 1872 (musée du Louvre). On l'estime durant sa vie pour des œuvres (La Fuite en Égypte, 1840, église de Rosny-sur-Seine) qui sont aujourd'hui oubliées. Dès ses années de Rome, Théodore Caruelle d'Aligny (1798-1871), à la terrasse du café Greco où se retrouvent les paysagistes, l'avait appelé “notre maître”. Corot eut en effet de nombreux élèves et une foule d'imitateurs – d'où les faux Corot que l'on trouve dans tous les musées du monde et les problèmes d'attribution que posent bon nombre des toiles qui lui sont trop généreusement données. Par ses dessins, son œuvre gravé – Corot, auteur d'une centaine de planches, pratiqua l'eau-forte, la lithographie, le cliché-verre surtout –, le nombre important de ses peintures – peut-être un peu moins de trois mille œuvres –, Corot exerça une grande influence sur tous les suiveurs qui adoptèrent sa manière mais aussi sur les artistes du groupe de Barbizon – et ainsi, dans l'Europe entière, en particulier chez les Macchiaioli italiens à la génération suivante. Influence Corot est parfois appelé le père de l’impressionnisme. Toutefois, c’est une appréciation qu’il faut nuancer. Ses recherches sur la lumière, sa prédilection pour le travail sur le motif et pour le paysage saisi sur le vif anticipent l’impressionnisme. Mais Corot craignait les bouleversements, en art comme en politique, et il est resté fidèle toute sa vie à la tradition néoclassique, dans laquelle il avait été formé. S’il s’en est écarté, vers la fin de sa carrière, c’est pour s’abandonner à l’imagination et à la sensibilité dans des souvenirs, qui annoncent le symbolisme autant ou davantage que l’impressionnisme. Corot, inspiré par Nicolas Poussin et Pierre-Henri de Valenciennes, peint en plein air ses études qu'il n'expose jamais, réalise ses tableaux en atelier puis à partir des années 1850 peint des tableaux de souvenirs faits de réminiscences. Faire de Corot le père de l’impressionnisme semble ainsi être hasardeux, notamment du fait que le courant impressionniste s’est développé largement en dehors de lui, voire malgré lui, même s’il n’y est pas resté entièrement étranger ; et trop peu, parce que Corot a bâti une œuvre assez riche et variée pour toucher à tous les courants de son époque. Corot réalise en fait la transition entre la peinture néoclassique et la peinture de plein air. Corot a lui-même influencé un grand nombre de peintres français. Louis Carbonnel aurait écrit à sa femme en 1921 : Sans Corot, il n'y aurait point de Gadan ni de Carbonnel. Il n'y aurait point de lumière . Dès 1835, la notoriété de Corot s'établit avec ses envois aux Salons. Ce sont de vastes compositions mythologiques ou bibliques : Silène, 1838, collection privée, Homère et les bergers, 1845, Saint-Lô, Destruction de Sodome, 1857, Metropolitan Museum of Art, New York, Macbeth et les sorcières, 1859, Wallace Collection, Londres. Ce sont aussi des vues de Ville-d'Avray et de l'Italie, où il a fait deux autres voyages, 1834, 1843, autant de toiles qui n'atteignent pas, toutefois, à la plénitude poétique du Souvenir de Mortefontaine, 1864, Louvre. Les grands chefs-d'œuvre demeurent ceux où Corot mène jusqu'à la perfection son art des variations subtiles de tonalité : le Port de La Rochelle, 1852, Yale University, la Cathédrale de Mantes, 1869, Reims, le Beffroi de Douai, 1871, Louvre, l'Intérieur de la cathédrale de Sens, 1874, ibid. On doit le reconnaître comme le doyen des naturalistes dira de lui Émile Zola les Paysagistes, 1868. Corot portraitiste et dessinateur Les portraits et figures constituent une part capitale de l'œuvre de l'artiste, qui s'intéresse plus particulièrement à la femme : émouvants portraits de ses proches Claire Sennegon, 1838, Louvre ; Femme en bleu, 1874, ibid., nus chastes ou troublants, l'Odalisque romaine, dite Marietta, 1843, Petit Palais ; Nymphe couchée, 1855, musée d'Art et d'Histoire, Genève ; la Toilette, 1859, collection privée, figures saisies sur le vif ou issues de songes, la Lecture interrompue, 1868, Art Institute, Chicago ; la Jeune Grecque, vers 1869, Metropolitan Museum of Art ; Jeunes Filles de Sparte, id., Brooklyn Museum, New York ; Jeune Femme algérienne couchée sur l'herbe, vers 1873, Rijksmuseum, dont l'apothéose est la Femme à la perle vers 1869, Louvre. Parmi 600 dessins que Corot a laissés, les uns sont exécutés à la mine de plomb Civita Castellana, 1827, Louvre, les autres au fusain, Macbeth, 1859. Beaucoup sont des ébauches en vue de tableaux. Certains, au contraire, constituent des œuvres abouties, la Petite Fille au béret, 1831, Lille ; Fillette accroupie, vers 1838, Louvre. Venu tardivement à l'estampe, Corot en sera un maître. Il est l'auteur d'une quinzaine d'eaux-fortes et d'autant de lithographies – paysages pour la plupart –, mais surtout de près de 70 clichés-verre, exécutés à partir de 1853 suivant un procédé mis au point par ses amis photographes à Arras. Vrais et faux Corot Les Corot authentifiés se comptent par centaines et se répartissent dans les collections du monde entier. Les plus importantes se trouvent en Amérique. En France, ce sont les musées du Louvre et d'Orsay, à Paris, ainsi que le musée de Reims, en région, qui conservent le plus grand nombre d'œuvres. Il reste que Corot est l'un des artistes le plus visés par les faussaires. On a attribué au peintre, pour des raisons de lucre, des toiles de contemporains qui dénotaient une appartenance à la même esthétique. On est même allé jusqu'à effacer la signature de petits maîtres au bas de tableaux qui étaient ensuite présentés comme des Corot non signés. Le marché de l'art a également été envahi de copies, exécutées à Arras par des amis de Corot ou par ses élèves, dont on contesta parfois la bonne foi – d'autant que ces copies ont facilité nombre d'escroqueries. Œuvres Liste des tableaux de Jean-Baptiste Corot La Rochelle, entrée du port 1851, collection Georges Renand, Paris Corot est surtout connu comme peintre de paysages, mais il est également l’auteur de nombreux portraits (proches ou figures de fantaisie). Il travaille vite, par des touches rapides et larges, et joue sur la lumière, grâce à une grande observation. Dès son vivant sont apparus des faux Corot faussaires, pasticheurs, sans compter les répliques par Corot lui-même ou ses œuvres qu'il prête à ses élèves, collègues ou amis pour qu'ils les copie qui accréditent la légende selon laquelle il serait l’artiste qui détiendrait le record du plus grand nombre de faux : ayant peint de son vivant près de 3 000 tableaux (et autant de dessins et gravures, 10000 versions signées du peintre existeraient dans les collections américaines. La collection du docteur Edouard Gaillot ou du docteur Jousseaume en sont de bons exemples. Celle de Jousseaume comprenait 2 414 faux Corot amassés tout au long de la vie du collectionneur17 : exposés comme authentiques en 1928 à Londres, ils sont même publiés dans un catalogue illustré malgré le Catalogue raisonné et illustré des œuvres de Corot, ouvrage de référence d'Alfred Robaut et d'Étienne Moreau-Nélaton édité en 1905. Sa signature en majuscule, COROT, est volontairement facile à reproduire, d'où de nombreuses erreurs d'attributions involontaires ou intentionnelles en raison de sa cote sur le marché de l'art qui, au cours du xxe siècle, voit surgir chaque année des centaines de nouvelles œuvres signées du peintre. Ainsi est-il difficile de trouver en France un musée des beaux-arts qui n'expose pas une de ses toiles. Qui plus est, Corot n'hésite pas à retoucher ou remanier les toiles de ses élèves dans un souci pédagogique travail d'atelier courant dans la peinture ancienne et, pour aider quelques peintres dans la misère, signe parfois leurs tableaux. Parmi les œuvres les plus célèbres, on peut citer, chronologiquement : Autoportrait, Corot à son Chevalet 1825, Paris, musée du Louvre. Papigno, rives escarpées et boisées 1826, Valence France, musée des beaux-arts de Valence Le Pont de Narni 1826, Paris, musée du Louvre. Le Colisée vu des jardins Farnese 1826, Paris, musée du Louvre. La Promenade de Poussin, campagne de Rome, 1825-1828, peinture sur toile, 33 × 51 cm, musée du Louvre, Paris. La vasque de la villa Médicis 1828, Reims, musée des beaux-arts. Rome, Le Tibre au Château Saint-Ange 1826-1828, Paris, musée du Louvre. L’Île de San Bartolomeo 1826-1828, Boston, musée des beaux-arts de Boston. Barques à voiles échouées à Trouville 1829, Paris, musée d'Orsay. La Cathédrale de Chartres 1830, Paris, musée du Louvre voir aussi dessin mine de plomb. Le Havre. La mer vue du haut des falaises 1830, musée du Louvre. Paysanne en forêt de Fontainebleau 1830-1832, musée d'art et d'archéologie de Senlis. Autoportrait, la palette à la main 1830 - 1835?, Florence, Corridor de Vasari, galerie des autoportraits de la Galerie des Offices. Portrait de Marie-Louise Laure Sennegon 1831, Paris, musée du Louvre. Volterra, le municipe 1834, Paris, musée du Louvre. Hagar in the Wilderness' 1835, Metropolitan Museum of Art. Vue de Florence depuis le jardin de Boboli v. 1835-1840, huile sur toile, 51 × 73,5 cm, musée du Louvre, base Joconde, ministère français de la Culture Fuite en Égypte 1840. Le Petit Berger 1840, Metz, musée de Metz. L’Église de Lormes 1841 Boston, Wadsworth Atheneum. Un champ de blé dans le Morvan 1842 Lyon, musée des beaux-arts. Marietta, L’Odalisque romaine 1843, Paris, musée du Petit Palais. Tivoli, les jardins de la Villa d'Este 1843, Paris, musée du Louvre La Cueillette , 1843, Musée des beaux-arts de Beaune Portrait de Madame Charmois dit Portrait de Claire Sennegon 1845, Paris, musée du Louvre. Le Baptême du Christ 1845-1847, Paris, église Saint-Nicolas-du-Chardonnet. Homère et les Bergers 1845, Saint-Lô, musée de Saint-Lô. Vue du Forum romain 1846, Paris, musée du Louvre. L’Église de Rolleboise près de Mantes entre 1850 et 1855, Paris, musée du Louvre. Le Port de La Rochelle 1851, New Heaven, Yale University Art Gallery. La Rochelle, avant-port 1851, Copenhague, Ny Carlsberg Glyptotek. La Femme à la perle 1869, musée du Louvre, Paris La Rochelle, entrée du port 1851, Paris, collection Georges Renand. Une Matinée, danse des Nymphes 1850-1851, Paris, musée d’Orsay. Le Bain de Diane 1855, musée des beaux-arts de Bordeaux Cavalier Dans le Bois 1850-1855, Londres, National Gallery. Tour au bord de l’eau 1829, Paris, musée d’Orsay. Le Coup de vent 1855-1860, Reims, musée des beaux-arts. Le Concert champêtre 1857, Chantilly, musée Condé. Nymphes désarmant Amour 1857, Paris, musée du Louvre. Prairie et marais de Corsept au mois d’août à l’embouchure de la Loire 1857, pour les personnages uniquement, le paysage étant de son ami Charles Le Roux, Paris, musée d'Orsay. Macbeth 1859, collection Wallace. Fillette à sa toilette 1860-1865 huile sur carton, Paris, musée du Louvre. Le Lac 1861. Meadow by the Swamp, Belgrade, musée national. Souvenir de Mortefontaine 1864, Paris, musée du Louvre. L’Arbre brisé 1865. Pré devant le Village 1865, Lyon, musée des beaux-arts. Mantes, la Cathédrale et la Ville vues à travers les arbres, le soir 1865-1868, Reims, musée des beaux-arts. Jeune Femme Au Puits 1865-1870, au State Museum Kröller-Müller. Femme avec des marguerites v. 1870 musée des beaux-arts de Budapest, Budapest Italienne assise jouant de la mandoline 1865 collection O. Reinhart Winterthur. Agostina 1866, Washington, Washington National Gallery. La Lecture interrompue 1865-1870, Chicago, Institut d'art de Chicago. L’Église de Marissel 1867, Paris, musée du Louvre. Le Pont de Mantes, 1868-1870, Paris, musée du Louvre. La Femme à la perle 1869, Paris, musée du Louvre. Le Beffroi de Douai 1871, Paris, musée du Louvre. L’Étang de Ville-d’Avray 1871 musée des beaux-arts de Rouen Près d’Arras 1872, Arras, musée municipal. Pastorale — Souvenir d’Italie 1873, Glasgow, Glasgow Corporation Art Gallery. Sin-le-Noble 1873, Paris, musée du Louvre. Dunkerque, vue du port de pêche 1873, collection O. Reinhart Winterthur. La Femme en bleu 1874, Paris, musée du Louvre. L’Intérieur de la cathédrale de Sens 1874, Paris, musée du Louvre. Liseuse interrompant sa lecture 1874, huile sur toile, 55 × 45 cm. Arbres et Rochers à Fontainebleau XIXe siècle, 4e quart, Arras, musée des beaux-arts L’Atelier Jeune Femme au corsage rouge 1853-1865, Paris, musée d’Orsay. Souvenir de Coubron 1872) musée des beaux-arts de Budapest, Budapest Bohémienne rêveuse 1865-1870, Paris, collection privée. Jeune Femme allongée, dessin, coll. Ernst Rouart. Mornex Haute-Savoie 1842, dessin, Paris, musée du Louvre Jeune Femme assise, les bras croisés, 1835-1845, dessin, Paris, musée du Louvre; et de nombreux autres dessins. Jeune Fille au béret, dessin, Lille, musée des beaux-arts. Orphée ramenant Eurydice des enfers 1861, Museum of the fine arts, Houston. Le Moine au violoncelle 1874, Hambourg, Hamburger Kunsthalle Biblis 1875, à titre posthume. Les Plaisirs du soir 1875, à titre posthume Les Bûcheronnes 1875, à titre posthume) musée des beaux-arts d'Arras ? Note : Alfred Robaut avait répertorié tous les tableaux de Corot, mais trois cents sont réputés perdus. Décorations 1847 - Chevalier de la Légion d'honneur 1867 - Officier de la Légion d'honneur Musées, monuments En Belgique Musées royaux des beaux-arts de Belgique, Bruxelles En France Musée Faure d’Aix-les-Bains Musée des beaux-arts d'Arras Musée des beaux-arts de Boulogne-sur-Mer Musée des beaux-arts de Beaune Musée des beaux-arts de Lyon Musée des beaux-arts de Lille Musée d'Orsay, Paris Musée du Louvre, Paris Musée des beaux-arts de Reims Musée des beaux-arts de Rouen Musée des beaux-arts de La Rochelle Musée d'art et d'archéologie de Senlis Musée du Pollas-Grandes Auberge Ganne à Barbizon. Musée des beaux-arts de Bordeaux En Suisse Musée d'art et d'histoire de Genève Château de Gruyères - Salon Corot Citations et avis Selon Charles Baudelaire, l’œuvre de cet héritier romantique de Watteau est un miracle du cœur et de l’esprit. « À la tête de l’école moderne du paysage, se place M. Corot.- Si M. Théodore Rousseau voulait exposer, la suprématie serait douteuse. Charles Baudelaire, Salon de 1845. « Corot est un peintre de race, très personnel, très savant, et on doit le reconnaître comme le doyen des naturalistes ... la fermeté et le gras de sa touche, le sentiment vrai qu’il a de la nature, la compréhension large des ensembles, surtout la justesse et l’harmonie des valeurs en font un des maîtres du naturalisme moderne. » Émile Zola, Les Paysagistes, 1868. « Il est toujours le plus grand, il a tout anticipé… » Edgar Degas, 1883. « Il y a un seul maître, Corot. Nous ne sommes rien en comparaison, rien. Claude Monet, 1897. Élèves Corot a eu comme élèves des peintres traditionnellement associés à l’impressionnisme, ou considérés comme pré-impressionnistes, notamment : Auguste Anastasi 1820-1889 Louis-Augustin Auguin Eugène Boudin Antoine Chintreuil1816-1873 Alexandre Defaux 1826-1900 François-Louis Français1814-1897 Louis Aimé Japy 1839-1916 Marcellin de Groiseilliez Antoine Guillemet 1843-1918 Eugène Lavieille 1820-1889 arrive à l'atelier en 1841 Stanislas Lépine, Charles Le Roux 1814-1895 Berthe Morisot Camille Pissaro Iconographie Une médaille à l'effigie de Corot, témoignage d'admiration pour son œuvre, a été commandée par ses amis et admirateurs au sculpteur Adolphe-Victor Geoffroy-Dechaume en 1874. Un exemplaire en est conservé au musée Carnavalet.            
#368
François-Edouard Picot
Loriane
Posté le : 14/03/2015 19:49
Le 15 mars 1868, à Paris, meurt François-Édouard Picot
né à Paris le 17 octobre 1786, peintre néoclassique français. Il appartient au mouvement artistique Néoclassicisme, il influença Paul Chevandier de Valdrome, il reçu pour récompense le 2ème prix de Rome en peinture de 1811? Ses Œuvres les plus réputées sont : L'Amour et Psyché 1817, Paris, musée du Louvre. Élève de François-André Vincent et de Jacques-Louis David à l'École des beaux-arts de Paris, il reçoit le second grand prix de Rome en 1811. De retour à Paris après son séjour romain à la Villa Médicis, il expose L'Amour et Psyché au Salon de 1819 et peint la même année La Mort de Saphire pour l'église Saint-Séverin de Paris. Il est élu membre de l'Académie des beaux-arts en 1836 et continue à exposer ses peintures au Salon jusqu'en 1839. Il décore avec Hippolyte Flandrin l'église Saint-Vincent-de-Paul de Paris et peint à la cire la fresque figurant Les Pèlerins d'Emmaüs pour l'église parisienne de Saint-Denys-du-Saint-Sacrement. Il réalise également des tableaux et des fresques pour le musée du Louvre, le château de Versailles et le palais du Luxembourg. À la fois peintre d'histoire, peintre de genre et portraitiste, François-Édouard Picot a été plus apprécié pour les mérites de son enseignement que pour ses talents de peintre. Sa vie Fils de François-André Picot, brodeur de l'empereur Napoléon Ier, le peintre François-Édouard passa son enfance dans le milieu de l'artisanat de luxe qui contribuait avec les artistes aux fastes de l'Empire. Dès quatorze ans, il entre dans les ateliers de Léonor Mérimée, secrétaire perpétuel de l'Académie des beaux-arts, et de François-André Vincent. Il reçoit de leur enseignement l'idéal classique exprimé par l'école de David et une grâce héritée du XVIIIe siècle français. Deuxième prix de Rome en 1811, il est deuxième premier grand prix en 1813. Grâce à ce classement honorifique il reçoit de Montalivet, ministre de l'Intérieur, une bourse spéciale qui lui permet de se rendre à Rome. Après la chute de l'Empire et la ruine de son père, Picot a le privilège exceptionnel de recevoir une allocation spéciale qui lui permet d'accomplir, à l'égal d'un premier grand prix, un séjour de cinq ans à Rome. Si la première œuvre connue de Picot, La Rencontre d'Énée et de Vénus près de Carthage, 1813 ; Musée royal des beaux-arts de Bruxelles, relève encore d'une technique et d'une sensibilité d'élève, L'Amour et Psyché au musée du Louvre, qu'il expose au Salon de 1818, lui vaut un triomphe. Le public le préféra à David qui présentait la même année un sujet identique. Ce tableau, acheté par le duc d'Orléans, répond au goût de la Restauration qui alliait à la mode néo-classique la nostalgie d'un art plus raffiné, plus féminin et plus évocateur de l'Ancien Régime. La carrière de Picot est celle d'un peintre officiel issu du concours pour Rome. Il reçoit des commandes de l'État, deux plafonds du musée Charles-X, aujourd'hui salles égyptiennes du musée du Louvre, des décors pour le Sénat et de nombreuses commandes pour Versailles. En 1836, il succède à Carle Vernet à l'Académie des beaux-arts. La politique artistique instaurée par Louis XVIII et Charles X et la recherche d'un art adapté au sentiment religieux font de Picot, décorateur à Paris de Notre-Dame-de-Lorette en 1836, Saint-Denis-du-Saint-Sacrement en 1844 et Saint-Vincent-de-Paul, 1853 un spécialiste de la peinture religieuse. Ferme défenseur de la tradition classique, Picot se retire des salons dès 1839. Sa dernière présentation, Un épisode de la peste à Florence, musée de Grenoble, atteste sa volonté de maintenir la suprématie de la peinture d'histoire sur la peinture de genre et les valeurs plastiques de la composition sur la manière romantique. Il se consacre ensuite à son atelier et à l'enseignement de la bonne peinture. L'atelier de Picot entre 1820 et 1860 a compté quelque cinq cents élèves, dont seize premiers grands prix de Rome qui figureront parmi les grands noms du second Empire : Isidore Pils, Alexandre Cabanel, William Bouguereau, les frères Bénouville. L'influence du peintre sur des talents de nature très différente Guillaumet ou Gustave Moreau fut considérable. Son atelier est un des chaînons majeurs qui explique la transmission de l'idéal classique au XIXe siècle. Sylvain Bellenger Il est inhumé à Paris au cimetière du Père-Lachaise 7e division Galerie Œuvres de François-Édouard Picot L'Amour et Psyché 1817, Paris, musée du Louvre. Portrait d'Adélaïde-Sophie Cléret, Mme Tiolier vers 1817, Cambridge, Fitzwilliam Museum. Les Pélerins d'Emmaüs, 1840, Paris, église Saint-Denys-du-Saint-Sacrement. Cybèle protège contre le Vésuve les villes de Stabiae, Herculanum, Pompéi et Résina 1832, Paris, musée du Louvre. Guy de Lusignan vers 1843, château de Versailles, Salles des Croisades. Conrad de Montferrat, château de Versailles, Salles des Croisades. Élèves Picot a eu de très nombreux élèves, parmi lesquels : Paul Léon Aclocque, Theodor Aman, André-Henri Dargelas Charles-Alphonse-Paul Bellay, Prix de Rome Léon Belly, Jean-Achille Benouville, François-Léon Benouville, Étienne-Prosper Berne-Bellecour 1838-1910, William Bouguereau, Prix de Rome Guillaume-Charles Brun, Ulysse Butin 1838-1883, Alexandre Cabanel, Philip Hermogenes Calderon, Théophile-Narcisse Chauvel, Charles-Camille Chazal, Ferdinand Chaigneau, Édouard Cibot, Georges Clairin, Félix-Auguste Clément, Charles-Alexandre Coëssin de la Fosse 1829-1910 Henri Coroenne, Victor-Gustave Cousin, Charles Alexandre Crauk, Gustave Droz, Charles-Antoine Flajoulot, Félix Giacomotti, Gustave Guillaumet, Léon Albert Hayon, Jean-Jacques Henner, Jozef Israëls, Auguste Leloir, Jules Eugène Lenepveu, Louis Hector Leroux, Étienne Leroy, Émile Lévy, Henri-Léopold Lévy, Henry Stacy Marks, Gustave Moreau, Alexis Mossa, Victor Mottez, Alphonse de Neuville, Léon Perrault, Isidore Pils, Claudius Popelin, Antoine Rivoulon, Édouard Sain, Elihu Vedder, Jean-Georges Vibert, Paul Alphonse Viry.  zééééééééééééw         
#369
Victor Vasarely
Loriane
Posté le : 14/03/2015 22:00
Le 15 mars 1997 à Paris, meurt à 90 ans Victor Vasarely,
né Győző Vásárhelyi le 9 avril 1906 à Pécs Hongrie, plasticien hongrois, naturalisé français en 1961, reconnu comme étant le père de l'art optique. Il appartient au mouvement artistique, art optique, Bauhaus. Ses Œuvres les plus réputées sont Zebra 1938, Portrait du président Georges Pompidou en 1977 En bref Victor Vasarely est né en Hongrie, à Pécs. Les professeurs du Bauhaus, Albers, Moholy-Nagy, ont fortement marqué l'enseignement qu'il suit à Budapest. Quand il s'installe à Paris, en 1931, il travaille comme graphiste. Il est dessinateur dans l'agence de publicité qu'il dirige jusqu'en 1956, un an après le lancement de son Manifeste Jaune 1955 acobsen. C'est le plein moment de l'art cinétique, et plus précisément de l'op art, pour lequel le mouvement est causé d'abord par le jeu des mécanismes de la perception et des illusions d'optique. Vasarely participe à l'exposition en montrant des plaques de verre suspendues : les mouvements qui se produisent entre elles font se transformer indéfiniment les motifs linéaires. On lit dans son manifeste : En effet, nous ne pouvons laisser l'œuvre d'art à la seule élite des connaisseurs. L'art présent s'achemine vers des formes généreuses, à souhait recréables ; l'art de demain sera trésor commun ou ne sera pas. ... Il est douloureux mais indispensable d'abandonner d'anciennes valeurs pour s'assurer la possession de nouvelles. Notre condition a changé, notre éthique, notre esthétique doivent changer à leur tour. Si l'idée de l'œuvre plastique résidait jusqu'ici dans une démarche artistique, et dans le mythe de la pièce unique, elle se trouve aujourd'hui dans la conception d'une possibilité de recréation, de multiplication et d'expansion. Après un premier moment figuratif, Vasarely met au point, dès 1947, un vocabulaire abstrait, un « alphabet plastique », dit-il, à partir duquel il peut générer ses « prototypes-départ. Chaque création est le fait d'une programmation à partir des formes de base, portée à son échelle de réalisation par des techniques propres – jusqu'à avoir des procédés à breveter – et par les exécutants les plus compétents, selon le support (par impression, par projection, sur toile, sur mur... Bien loin de la peinture de chevalet, du mythe de l'original, orienté vers l'anonymat de la facture, Vasarely conquiert les espaces publics et l'architecture. Les commandes se succèdent, du portail de l'université de Caracas en 1957 au portrait du président défunt dans le hall du Centre Georges-Pompidou en 1977, en passant par de nombreux projets intégrés à l'architecture cloisons dans les bâtiments de l'ex-Régie Renault, objet d'un litige judiciaire au début des années 1990. Vasarely a exposé à Paris et dans toute l'Europe. Il fait figure de précurseur dans l'exposition The Responsive Eye en 1965 au Museum of Modern Art à New York, comme dans Lumière et mouvement en 1967 au musée d'Art moderne de la Ville de Paris. La rétrospective de 1969 à Budapest marque sa consécration. Dans le prolongement de son œuvre de peintre, Vasarely fonde les musées didactiques de Gordes 1970 et de Pécs 1976, en Hongrie, et fait construire selon ses propres plans, à partir de 1971, sa propre fondation près d'Aix-en-Provence. Des errements dans la gestion de cette dernière font apparaître le nom de Vasarely dans les chroniques judiciaires et assombrissent un héritage qui, dans une perspective historique, mérite pourtant une considération toute particulière. Christophe DOMINO Sa vie Victor Vasarely commence des études de médecine, qu'il arrête au bout de trois ans. Il s'intéresse alors au Bauhaus et étudie au Műhely de Budapest de 1928 à 1930.Il se forma en Hongrie à l'Académie Pololini-Volkmann, puis à l'académie Muhely de Budapest sous la direction de Sandor Bortnyk, en 1929. Établi à Paris en 1931, il travaille dans la publicité Havas, Draeger et, de 1936 à 1944, conçoit une œuvre graphique importante d'où il tire sa propre sémantique. En 1932, il s'installe à Paris où il débute comme artiste graphiste dans des agences publicitaires comme Havas, Draeger, Devambez. C'est là qu'il effectue son premier travail majeur, Zebra 1939 considéré aujourd'hui comme le premier travail dans le genre op art. Pendant les deux décennies suivantes, Vasarely développe son propre modèle d'art abstrait géométrique, travaillant dans divers matériaux, mais employant un nombre minimal de formes et de couleurs. Il participe en 1944 à la fondation de la gal. Denise René, qu'il inaugure avec sa première exposition. Une série de portraits, Autoportrait, Antonin Artaud exécutés en 1946 témoignent de ses préoccupations dans un esprit postcubiste, mais parfois curieusement " éclaté " : Sept Ans de malheurs. Très rapidement, à partir de 1952, Vasarely aborde l'Abstraction. Le champ chromatique est réduit à quelques couleurs, et la ligne, élégante et souple, y joue un rôle dynamique. Un séjour à Belle-Île-en-Mer 1947 et la découverte du galet ayant affermi l'artiste dans son idée, dès lors constante, que " les langages de l'esprit ne sont que les supervibrations de la grande nature physique ", la période " cristal " Gordes, Vaucluse, 1948 repose sur le même passage d'une réalité à la synthèse. La conquête du Cinétisme apparaît en filigrane dans l'œuvre de Vasarely. Elle n'est pas subite et accidentelle, mais elle est le terme d'un labeur constant et acharné. Ces jalons du Cinétisme, Vasarely les a lui-même situés dans Étude bleue 1930, Folklore, où il reprend les particules colorées d'un Klimt, de caractère Modern Style, suivant un processus d'organisation dynamique de la surface. La série des Zèbres 1932-1942 définit enfin l'esprit de toutes les recherches ultérieures. Dès lors, l'artiste a progressé à partir de ses données anciennes, passant de la peinture de chevalet au mur et de la surface au volume, introduisant enfin des matériaux nouveaux aluminium, verre en vue de préparer l'intégration de ses œuvres à l'architecture, qui est finalement son but suprême : cité universitaire de Caracas, avec un décor mural en hommage à Malevitch, compositions en céramique et lames d'aluminium, réalisation dans le cadre des constructions de Jean Ginsberg, à Paris, immeubles du boulevard Lannes, de l'avenue de Versailles, de la rue Camou ; H. L. M. de la ville de Meaux, sculpture polychrome à Flaine Haute-Savoie, tapisseries tissées à Aubusson. Vasarely a réalisé aussi une importante œuvre graphique : Chell 1949, Album Vasarely 1958, Album III 1959, Constellations 1967, sérigraphies. Parce qu'il est à la fois peintre et sculpteur, il est plutôt un plasticien, un metteur en scène de la couleur et de l'espace. Il a ardemment milité pour la création d'un espace mural animé par des effets d'optique, l'abandon du tableau de chevalet et vise à renouer avec la tradition de la Renaissance, qui ambitionnait un art total. L'artiste a défini sa méthode dans de nombreux ouvrages, en particulier Plasti-Cité paru en 1970. Il est représenté dans de nombreux musées d'art moderne. Une exposition Vasarely, 50 ans de création a été présentée à Lausanne, musée Olympique, en 1996, et à Libourne, M. B. A., la même année. Le Christ et Saint Pierre, les deux seules œuvres religieuses de l'artiste sont exposées dans la crypte de la cathédrale d'Évry. Il travaille aussi pour de nombreuses entreprises et métamorphose en 1972 avec son fils, le plasticien Yvaral 1934-2002, le logo de Renault. Vasarely meurt, à l'approche de ses 91 ans, des suites d'un cancer de la prostate. Fondation et musées Vasarely La fondation Vasarely est une institution à but non lucratif, créée par l'artiste avec son épouse Claire, et reconnue d'utilité publique en 1971. Elle comprend le musée didactique de Gordes 1970-1996 et le centre architectonique d'Aix-en-Provence 1976 ainsi que deux musées didactiques à Pécs 1976 et à Budapest 1986. Les musées Vasarely de Pécs et de Budapest conservent des donations inaliénables ; celui de Pécs possède des œuvres d'autres artistes de sa collection, Soto, Morellet, Yvaral, Claire Vasarely. Pierre Vasarely, le petit-fils de l'artiste, est son légataire universel, le titulaire du droit moral sur son œuvre et le président de la fondation Vasarely. Cote de l'artiste Son œuvre IBADAN-POS 1957, mesurant 190 cm sur 170 cm et constituée de traits noirs sur un fond blanc, a été vendue pour 226 000 euros à Cologne         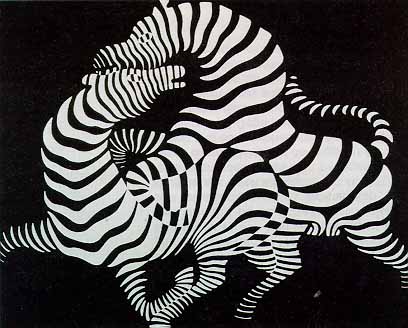 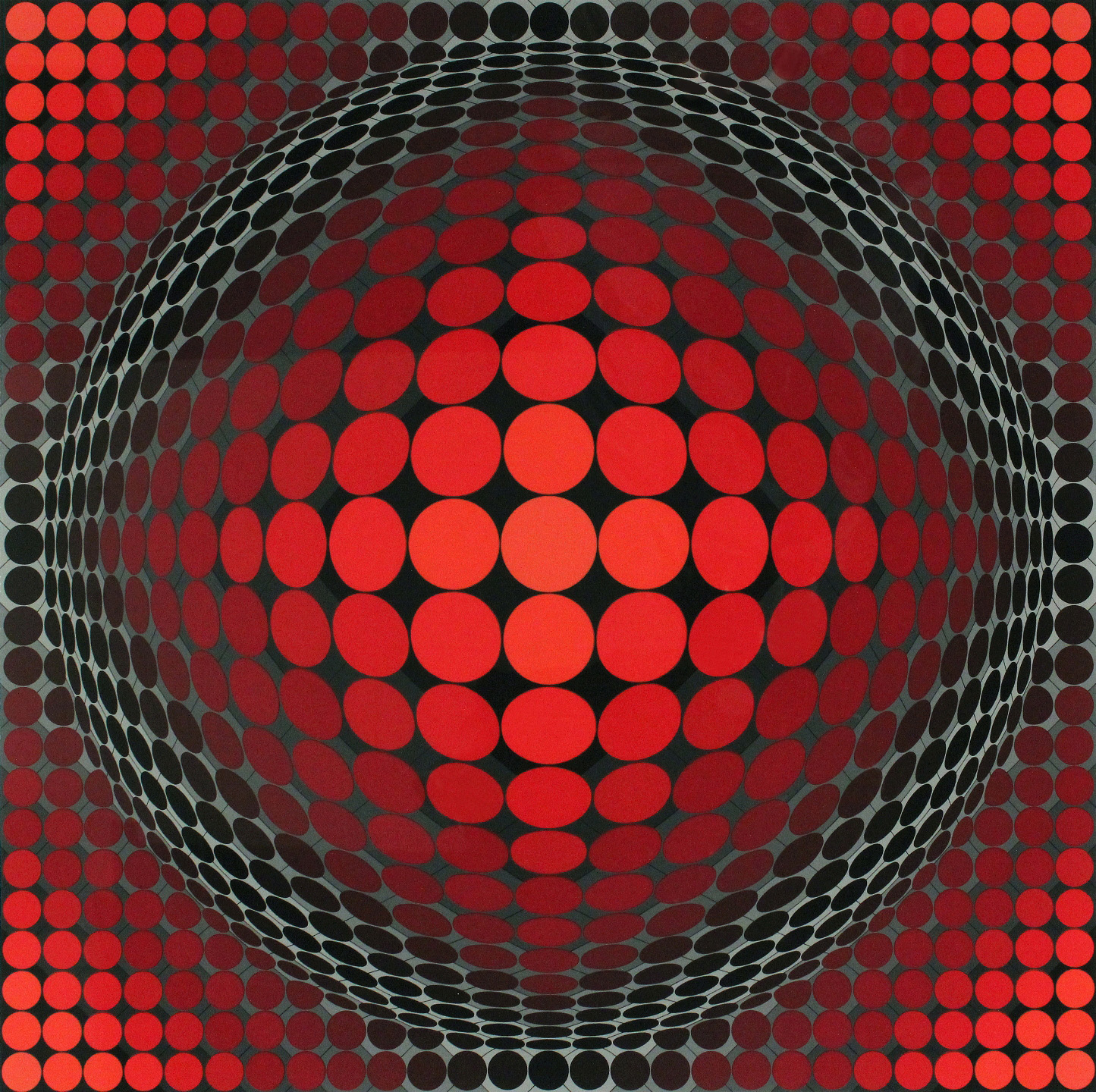 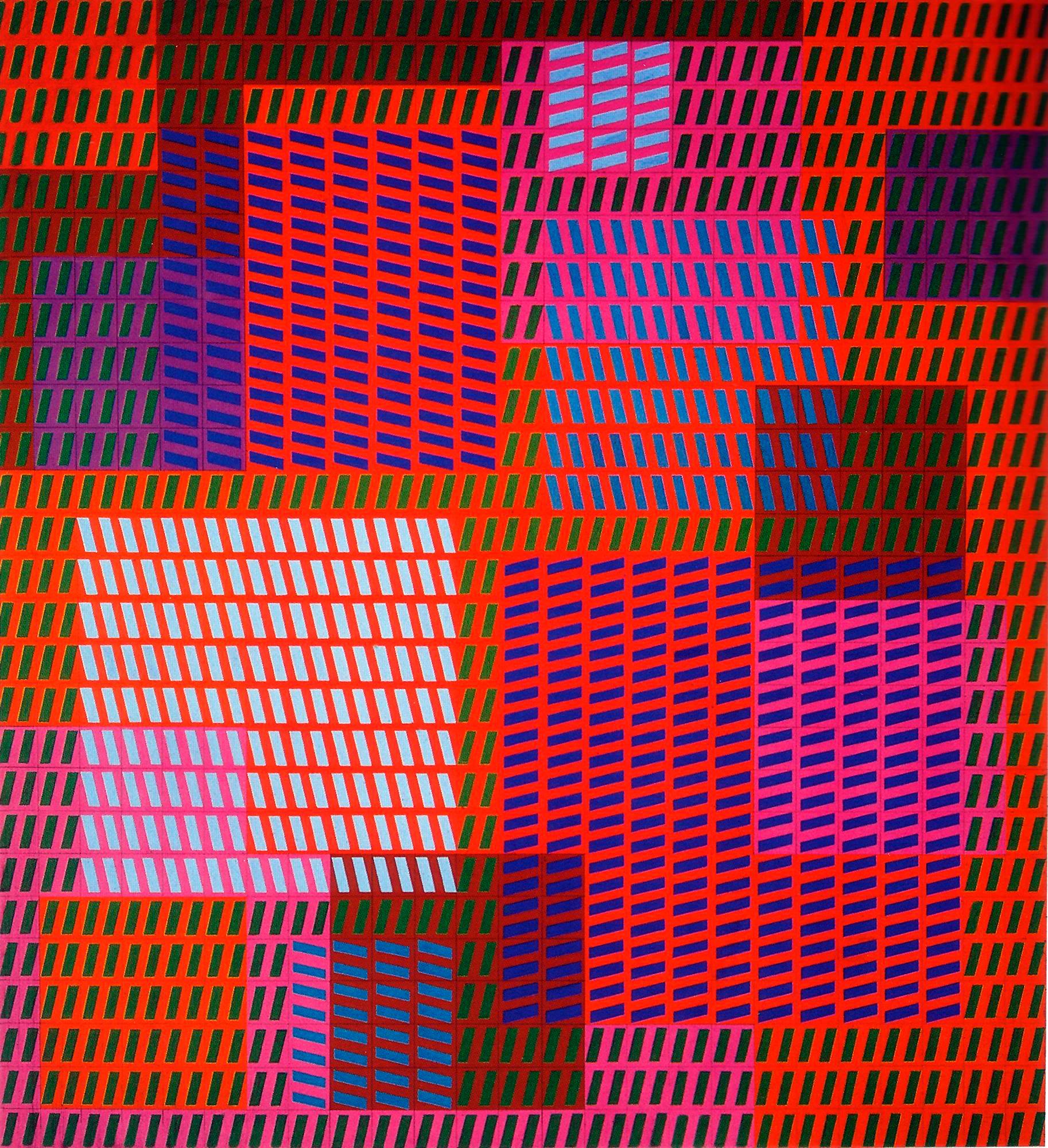 
#370
Agostino Carracci
Loriane
Posté le : 21/03/2015 15:11
Le 22 mars 1602 à Parme meurt Agostino Carracci
dit aussi Caracci ou Augustin Carrache, né à Bologne le 16 août 1557, peintre italien de la Renaissance. Il s'est surtout illustré par le tableau de la Communion de St Jérôme regardé comme un chef-d'œuvre. Augustin aida son frère Annibal dans une partie des travaux de la galerie Farnèse. Il est également célèbre comme graveur ; enfin, il composa pour l'Académie de Bologne un Traité de perspective et d'architecture. Les gravures d'Augustin Carrache ont également été copiées par de nombreux autres artistes tel que Cornélis Galle par exemple. Carrache est le nom de deux frères, Agostino en français Augustin, Bologne 1557-Parme 1602 et Annibale ou Annibal Bologne 1560-Rome 1609, et de leur cousin Ludovico Louis Bologne 1555-Bologne 1619, peintres italiens, auteurs de tableaux religieux, décorateurs et fondateurs à Bologne de l'académie d'art des Incamminati 1585, où travaillèrent G. Reni, F. Albani, le Dominiquin, le Guerchin… Comme celui de leur contemporain Caravage, le rôle des Carrache dans l'évolution de la peinture européenne à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle est à la fois révolutionnaire et capital. À la tradition artificielle et raffinée d'un maniérisme qui s'épuise, ils opposent le retour à l'étude directe de la nature et, en même temps, aux grands exemples de l'art du passé. Leur œuvre, surtout celle du plus célèbre d'entre eux, Annibal, fut justement appréciée jusque vers le début du XIXe siècle ; le reproche d'éclectisme fit alors perdre de vue ce qu'avait de novateur leur attitude, et ce n'est qu'au milieu du XXe siècle que des historiens comme H. Bodmer, O. Kurz ou D. Mahon, et aussi l'exposition de 1956 à Bologne, ont pu réhabiliter ces artistes. L'activité bolonaise Les Carrache sont originaires de Bologne, où Ludovic naît en 1555 et ses deux cousins germains Augustin et Annibal, respectivement en 1557 et 1560. Le milieu artistique local, si marqué qu'il fût par le maniérisme, tel est le cas de Prospero Fontana, qui aurait été le premier maître de Ludovic, n'avait jamais abandonné les références directes à la nature, comme le montre l'œuvre libre et variée d'un Bartolomeo Passerotti. Cette tendance est renforcée dans une certaine mesure par l'arrivée du Flamand Denys Calvaert, qui ouvre une école à Bologne en 1570. À Florence également, chez Santi de Tito, chez Cigoli, naissait un maniérisme « réformé » que les jeunes Carrache ont pu connaître. Leur formation et leurs débuts restent néanmoins assez obscurs, en partie à cause de l'esprit de clocher ou des arrière-pensées de leurs premiers historiens. Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, le Bolonais Malvasia mettra l'accent sur les sources lombardes et réalistes de l'art de Ludovic – placé au premier rang parce qu'il ne quitta pas Bologne – tandis que le Romain Bellori préférera le dernier Annibal – dont l'activité se déroula à Rome – qui emprunte à l'Antiquité, aux classiques et donne une impulsion décisive au courant « idéaliste » de la peinture du XVIIe siècle. Les premières œuvres des Carrache dont la date soit connue sont des gravures, pour la plupart dues à Augustin, qui pratiquera volontiers cet art jusqu'à la fin de sa courte vie. Augustin reproduit d'abord des œuvres locales, Sabattini ou des peintures de Baroche. De 1582 datent les premières gravures d'après de grandes œuvres vénitiennes, Tintoret, Véronèse, qui peuvent faire croire à un séjour à Venise. En 1583, Annibal peint la Crucifixion de l'église Santa Maria della Carità de Bologne, où apparaissent déjà, avec une composition très simple, une solidité des formes et un accent réaliste très en avance sur les contemporains, à l'exception sans doute de Bartolomeo Cesi. Au même moment, les trois cousins travaillent ensemble à leur première grande entreprise décorative, celle de trois salles du palais Fava (Histoire de la nymphe Europe, de Jason, d'Énée. Les principales peintures, à peu près conservées, reprennent la tradition, illustrée auparavant par un Nicolo dell'Abbate, des frises à la fresque au sommet des murs. Au début de 1585 se place l'épisode capital du voyage d'Annibal et d'Augustin à Parme, où ils étudient l'œuvre de Corrège. Chez celui-ci, Annibal trouvait la trace des formes grandioses de Michel-Ange, découvrait le sens du pathétique, l'intensité du coloris, la douceur et la science du modelé qui marqueront ses œuvres, à commencer par la Déposition de croix en 1585, Parme puis l'Assomption en 1587, Dresde. On s'accorde à placer vers la même date une œuvre qui est apparemment aux antipodes de cette culture parmesane, l'extraordinaire Boucherie de Christ Church à Oxford, dont le réalisme intense se retrouvera dans le Mangeur de fèves, Rome et dans plusieurs portraits. Peu après, les trois artistes fondent à Bologne une académie, dite des Incamminati, où les jeunes peintres pouvaient apprendre cette vérité nouvelle que la culture artistique ne doit pas empêcher d'observer le monde quotidien. Vers 1588, certains des caractères propres à l'art de Ludovic apparaissent dans les premiers tableaux datés par lui que nous conservions, Conversion de saint Paul et Madone des Bargellini Bologne : un sentiment religieux très vif et comme ému, une simplicité des formes et des draperies qui permet de faire chanter de larges plages de couleurs chaudes, un luminisme énergique qui doit beaucoup à Tintoret. On peut situer à la même époque le voyage à Venise d'Annibal, qui y admire particulièrement Véronèse, Madone de saint Matthieu, 1588, Dresde. Entre 1588 et 1591, les Carrache peignent la frise du grand salon du palais Magnani à Bologne, où ils racontent en quatorze tableaux l'histoire de Romulus. Ici encore, la répartition des peintures entre les trois artistes, tentée à plusieurs reprises, reste bien difficile. La qualité de l'étude anatomique, le modelé raffiné de certains personnages, et notamment des figures nues qui séparent les scènes, sont sans doute à mettre au crédit d'Annibal. Dans l'un des morceaux les plus célèbres, auquel Ludovic a peut-être collaboré, La Louve, le fond témoigne de l'intérêt d'Annibal pour le paysage naturel. Son œuvre de paysagiste comprend d'abord des toiles à la fois réalistes et romanesques, Fête champêtre, Marseille, qui doivent beaucoup à la tradition vénitienne, La Chasse et La Pêche, Louvre, puis une série de paysages idéalisés, où formes naturelles et éléments d'architecture concourent à la construction du tableau, Concert sur l'eau, Louvre. Le premier type de paysage, où prédomine le détail réaliste et humain, sera développé par le Dominiquin, tandis que la forme finale et plus intellectuelle, celle du Paysage avec la fuite en Égypte, vers 1603, galerie Doria, Rome, inspirera tout le courant classique du paysage italien et surtout français du XVIIe siècle. Dans les dernières années de son séjour bolonais, Annibal peint des mythologies, Sommeil de Vénus, Chantilly et de grands tableaux d'autel dont les formes amples, qui évoquent encore Véronèse, se plient à des schémas clairs et équilibrés, Assomption de la Vierge, 1592, Bologne ; Résurrection du Christ, 1593, Louvre. Annibal à Rome En 1595, Annibal est appelé à Rome par le cardinal Farnèse ; il va pouvoir enrichir sa culture au contact de l'art antique et des grandes œuvres du début du siècle Raphaël, Michel-Ange, mais aussi recevoir du milieu lettré qui entoure son protecteur, Mgr Agucchi, Fulvio Orsini les programmes savants des grandes entreprises dont il est chargé au palais Farnèse. Il décore d'abord, 1595-1597 le Camerino de scènes tirées de l'histoire d'Ulysse et de celle d'Hercule. À partir de 1597 et jusqu'en 1605, il travaille au décor de la galerie Farnèse, qui illustre d'exemples mythologiques le thème du pouvoir de l'amour, et ses trois niveaux : bestial, humain et divin. Il put se faire aider pendant deux ans de son frère Augustin, puis, pour achever l'entreprise, d'élèves dont le principal fut le Dominiquin. Mais Annibal, comme en témoignent un grand nombre de dessins, est lui-même l'auteur de la conception d'ensemble et de l'exécution de presque toute la voûte. Le décor, dont divers éléments rappellent la chapelle Sixtine, englobe une série de tableaux dans une organisation complexe qui fait large place à l'illusion : fausses sculptures, cadres fictifs, tableaux censés masquer la frise décorative, angles ouverts sur un ciel imaginaire. L'ensemble est peint dans un coloris clair, avec une science supérieure de l'équilibre des formes et du modelé. Des générations entières de jeunes peintres viendront, jusqu'au XIXe siècle, étudier cette œuvre heureuse, à la fois savante et spontanée. Annibal trouve le temps de peindre en même temps de grands tableaux de chevalet, dont les formes monumentales et denses, Assomption de la Vierge, Rome se chargent parfois de pathétique, Pietà, Naples. Dans ses tableaux plus petits, reprenant la leçon de Raphaël, Annibal lie de façon magistrale figures et paysage, les deux Martyre de saint Étienne, Louvre ; Domine quo vadis ? Londres. Augustin et Ludovic La forte personnalité d'Annibal ne doit pas faire oublier celle de ses deux aînés. Augustin, qui meurt dès 1602, a laissé une œuvre graphique abondante ; ses gravures de reproduction traduisent brillamment par le jeu des tailles les oppositions d'ombre et de lumière ; son style personnel est ironique et souvent fort libre, série des Lascivie. Son œuvre peint est assez peu nombreux, sauf au cours de la période approximative 1590-1595, dans laquelle se place la célèbre Communion de saint Jérôme, Bologne, tableau qui inspirera le Dominiquin et Rubens. Le fils naturel d'Augustin, Antoine, 1589 env.-1619, fut également peintre ; mais son œuvre se réduit aujourd'hui à quelques tableaux dont l'étrange Déluge, Louvre. Quant à Ludovic, il exécute, entre 1590 et sa mort, 1619, des peintures que leur intense réalisme, leurs contrastes d'ombres et de lumières apparentent parfois à celles de Caravage, Flagellation, Douai ; Martyre de sainte Ursule, 1592, Bologne. La même force et un coloris intense dont se souviendra le Guerchin se retrouvent dans les saisissantes apparitions des tableaux colossaux de 1607-1608, conservés au musée de Parme mais qui proviennent de la cathédrale de Plaisance. L'œuvre des Carrache devait fortement stimuler la peinture européenne. Non seulement elle a profondément marqué leurs élèves bolonais, dont les plus grands furent le Dominiquin, Guido Reni, le Guerchin, l'Albane, mais elle a servi de modèle à tous les peintres qui s'efforcèrent de concilier l'imitation de la nature avec la recherche du beau idéal, en s'appuyant sur les grands exemples de l'art du passé. Au XVIIe siècle, cette attitude, qu'on a coutume d'appeler classique, fut celle de la majorité des peintres français et italiens, qui préféraient la leçon des Carrache à celle de Caravage, leur grand contemporain. Cette synthèse difficile entre le réalisme et la construction intellectuelle de la beauté devait être, pour la dernière fois dans l'art occidental, tentée et réussie par Ingres. Antoine Schnapper. L'académie des Carrache en Italien Carracci L'importance considérable des Carrache tient à la fois à la forme de leur enseignement, d'où est issu le mouvement académique européen, et à l'orientation qu'ils donnèrent pour deux siècles au moins à la peinture décorative. Issus d'un milieu modeste de petits artisans et commerçants, ils fréquentèrent les écoles d'art, nombreuses à Bologne, mais acquirent surtout leur formation par l'étude et la copie des grands maîtres, Corrège et Jules Romain, Véronèse, Titien et Tintoret, qu'Annibale et Agostino avaient étudiés à Venise. Agostino était surtout graveur et commença sa carrière dans l'atelier d'un praticien hollandais, chez qui l'on reproduisait tous les grands maîtres de l'école romaine de la Renaissance. Leur première œuvre commune fut la décoration à fresque du palais Fava, à Bologne, en 1582, date à laquelle on peut considérer leur formation comme terminée. La frise représentant la légende des Argonautes, 1584, dans la grande salle, eut assez d'admirateurs pour consacrer localement le talent des Carrache. En 1585, ils ouvrirent leur académie bolonaise. Dans un pays qui en comptait des centaines depuis le début du XVIe s., qu'apportait-elle de nouveau ? Elle était, comme les précédentes, un lieu de discussion sur la théorie des arts, des médecins, des poètes, parmi lesquels Giambattista Marino, dit le Cavalier Marin, la fréquentaient. Mais, pour la première fois, l'académie des Carrache offrait un vrai programme d'étude de perspective, d'architecture, d'anatomie- grâce à des moulages faits sur des cadavres comme sur des antiques- et surtout de modèle vivant. Les élèves étaient astreints à des exercices, scrupuleusement corrigés, et à des concours. On a fait de l'académie des Carrache le lieu de diffusion d'une doctrine dite éclectique, selon laquelle le moyen d'atteindre la beauté était de prendre chez chacun des grands maîtres de la Renaissance ce qu'il avait de meilleur. Mais on ne peut comprendre l'originalité des Carrache en exposant leur méthode de cette façon, car tous les grands artistes ont fait de tels emprunts. L'observation rigoureuse de la nature, autre principe des Carrache, n'était pas une nouveauté non plus. Mais, venant après l'époque du maniérisme, où le brio, la rapidité d'exécution et la subtilité intellectuelle des thèmes semblaient les qualités primordiales, le travail sérieux, minutieux, la soumission au modèle qui étaient de règle chez les Carrache prenaient l'allure d'une nouveauté. On a beaucoup exagéré l'opposition entre leur style et celui du Caravage, faisant de celui-ci le champion du réalisme et de ceux-là les ancêtres de l'académisme, usant alors de ce mot dans un sens péjoratif. Par rapport aux maniéristes, les Carrache ont bel et bien effectué un retour à la nature. Pendant les dix années qui suivirent la création de l'académie, l'activité des trois peintres fut essentiellement consacrée à la peinture religieuse. De cette époque datent, de Ludovico : la Madone dite des Scalzi de la pinacothèque de Bologne, l'Assomption de Dresde, la Pietà de Parme, la Vision de saint Hyacinthe du Louvre ; d'Annibale : la Madone apparaissant à sainte Catherine et à saint Jean Louvre, la Résurrection, Louvre, Saint Roch Dresde ; d'Agostino, enfin, la Dernière Communion de saint Jérôme, Vatican. Malgré de notables différences de style- plus de fidélité à la Renaissance classique chez Annibale, plus de sens du pathétique chez Ludovico-, de l'ensemble des peintures de cette époque se dégage un caractère mouvementé, allié à la solidité des compositions. En 1595, Annibale, rejoint pour peu de temps par Agostino- Ludovico conservant à Bologne la direction de l'académie-, reçut la charge de décorer la galerie du palais Farnèse à Rome, construite par Giacomo Della Porta. Les peintures de la voûte et du haut des murs furent consacrées à des sujets mythologiques, le centre du plafond représentant le Cortège de Bacchus et d'Ariane. Les panneaux situés aux extrémités de la galerie furent peints par le Dominiquin, élève bolonais des Carrache. Dans ces compositions pleines de mouvement et de réalisme, l'Antiquité est représentée avec une joie de vivre et un sens de la nature que l'on ne peut qualifier d'académiques. Cependant, nombreux y sont les symboles ; cet aspect didactique, autant que la science décorative et la clarté légère des tons- opposée à la violence des peintres « luministes, plut aux amateurs du xviie s. On s'en souviendra à Versailles et dans bien d'autres palais. Les peintures de la chapelle du palais Aldobrandini, en collaboration avec l'Albane et le Dominiquin, aujourd'hui à la galerie Doria Pamphili de Rome, montrent Annibale Carracci comme le père du paysage idéal. La filiation des Carrache englobe ainsi non seulement ses disciples immédiats, l'école bolonaise de la génération suivante, mais Poussin, l'Académie royale de peinture et de sculpture et, par conséquent, une bonne partie de la peinture européenne des XVIIe s. et XVIIIe s.            |
Connexion
Sont en ligne
80 Personne(s) en ligne (52 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)
Utilisateur(s): 0 Invité(s): 80 Plus ... |
| Haut de Page |





 IMG_1334.JPG (330.38 KB)
IMG_1334.JPG (330.38 KB)

